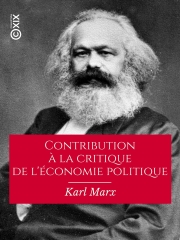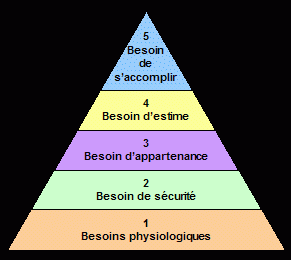Thème du débat : "Mémoire, mémoires... Cette mémoire qui nous construit, cette mémoire qui nous détruit"
Date : 30 novembre 2012 à la Brasserie du centre commercial de la Chaussée.
 Pour ce café philosophique spécial intitulé "Mémoire, mémoires… Cette mémoire qui nous construit, cette mémoire qui nous détruit" entre 80 et 90 personnes étaient présentes. Pour l’occasion, Claire et Bruno étaient accompagnés de Jean-Dominique Paoli.
Pour ce café philosophique spécial intitulé "Mémoire, mémoires… Cette mémoire qui nous construit, cette mémoire qui nous détruit" entre 80 et 90 personnes étaient présentes. Pour l’occasion, Claire et Bruno étaient accompagnés de Jean-Dominique Paoli.
Bruno le présente : Jean-Dominique Paoli, ancien professeur agrégé en économie et gestion, consacre depuis plusieurs années son temps libre dans l’étude de la mémoire et dans son entraînement quotidien. Il précise qu’il n’est certes pas spécialiste mais qu’il souhaite partager ses connaissances et son expérience sur les formidables capacités cognitives du cerveau. Notre invité entend faire de cette séance du café philosophique de Montargis un moyen de montrer que n’importe qui peut "muscler" son cerveau (quoique le terme de "muscle" n’est pas approprié pour cette partie du corps humain) et que, surtout, les petits accidents de la vie quotidienne (la perte d’un trousseau de clés ou celle d’un nom) ne sont pas dramatiques. Il s’agit également, ajoute Bruno, d’un café philo qui entendra rendre hommage au cerveau, mal connu, de taille modeste (1 % environ de la masse corporelle) mais puissamment irrigué : 20 à 25 % de notre sang passe par le cerveau !
Puisque nous sommes dans le cadre d’une animation philosophique, en ce début de séance, Claire propose au public de faire fonctionner ses méninges en citant de mémoire une liste de vingt philosophes qu’ils ont pu retenir. Cette liste est inscrite sur un tableau:
Nietzsche (n°1), Platon (n°2), Spinoza (n°3), Bergson (n°4), Kierkegaard (n°5), Schopenhauer (n°6), Descartes (n°7), Lavarède (sic) (n°8), Pascal (n°9), Kant (n°10), Teilhard de Chardin (n°11), Épicure (n°12), Sartre (n°13), Husserl (n°14), Socrate (n°15), Confucius (n°16), Alain (n°17), Marx (n°18), Montaigne (n°19), Lao Tseu (n°20).
Jean-Dominique Paoli mémorise pendant quelques minutes cette liste tout en continuant de converser avec les participants - ce qui rend l'exercice particulièrement difficile. Puis le tableau est retourné et caché.
 Jean-Dominique ne cache pas que l’utilisation de nos jours de la mémoire pose problème : alors que les maladies invalidantes – type Alzheimer – ont tendance à nous inquiéter, tout se passe comme si nous nous désintéressions de nos capacités mnémoniques. Il y a une explication à cela : notre vie quotidienne est de plus en plus riche d’instruments qui facilitent notre vie quotidienne – téléphones portables, Internet, moteurs de recherche, répertoires électroniques, etc. – au risque de rendre notre cerveau dépendant de ces machines. Combien sommes-nous à ignorer jusqu’à notre propre numéro de téléphone ? L’objet de cette séance sera donc nous ouvrir les yeux sur l’importance de cette mémoire.
Jean-Dominique ne cache pas que l’utilisation de nos jours de la mémoire pose problème : alors que les maladies invalidantes – type Alzheimer – ont tendance à nous inquiéter, tout se passe comme si nous nous désintéressions de nos capacités mnémoniques. Il y a une explication à cela : notre vie quotidienne est de plus en plus riche d’instruments qui facilitent notre vie quotidienne – téléphones portables, Internet, moteurs de recherche, répertoires électroniques, etc. – au risque de rendre notre cerveau dépendant de ces machines. Combien sommes-nous à ignorer jusqu’à notre propre numéro de téléphone ? L’objet de cette séance sera donc nous ouvrir les yeux sur l’importance de cette mémoire.
Il est d’ailleurs remarquable de constater que même chez étudiants et les adolescents, les plus à même d’utiliser la mémoire – voire de bien l’utiliser étant donné les qualités optimales de leur cerveau à leur âge –, cette faculté est inhibée. Qui n’a pas connu, les veilles d’examens, l’expérience de l’angoisse à l’idée que toutes les connaissances que l’on a mémorisées vont disparaître devant une copie blanche ? Il existe pourtant des moyens de gérer sa mémoire, réagit Jean-Dominique Paoli, tout en concédant que le stress (bien compréhensible dans le cas d’un examen) est délétère pour le cerveau. Ce dernier n’est jamais aussi efficace que lorsqu’il travaille dans le plaisir et le "politiquement incorrect". À ce sujet, il est frappant, remarque notre intervenant non sans humour, que parmi les premiers mots appris par les jeunes enfants figurent en bonne place le "vocabulaire du "pipi-caca" !
Rebondissant sur l’intervention d’une participante, il est entendu, dit Claire, que le sujet de ce soir entend parler de la mémoire personnelle, même si les concepts de mémoire historique ou de mémoire familiale ne sont pas déconnectés du sujet qui nous occupe, sujet qui mériterait à lui seul bien d’autres débats...
 Jean-Dominique Paoli définit la mémoire en la montrant comme multiple et plurielle. Une différence est faite entre mémoire rétrograde et de mémoire antérograde (la mémoire antérograde est la mémoire qui acquiert les informations nouvelles alors que la mémoire rétrograde celle qui a conservé les informations passées).
Jean-Dominique Paoli définit la mémoire en la montrant comme multiple et plurielle. Une différence est faite entre mémoire rétrograde et de mémoire antérograde (la mémoire antérograde est la mémoire qui acquiert les informations nouvelles alors que la mémoire rétrograde celle qui a conservé les informations passées).
Maintenir ces souvenirs acquis n’est cependant pas garantir leur perpétuation intacte et exacte. Nous nous construisons grâce à notre passé autant que nous reconstruisons ce passé ! Nos souvenirs sont perpétuellement revus, réexaminés, voire "reliftés". Bruno prend pour exemple une anecdote tragique narrée par Boris Cyrulnik dans son autobiographie récente Sauve-toi, la vie t’appelle (éd. Odile Jacob, 2012). Ce spécialiste de la résilience garde le souvenir de son arrestation avec ses parents le 18 juillet 1942. Alors qu’il n’a que cinq ans, il est enfermé dans la synagogue de Bordeaux. Une infirmière le dissimule sous un matelas où gît déjà une femme mourante, ce qui le sauvera de la mort. Or, la mémoire de l’enfant conserve le souvenir d’un soldat allemand entrant dans la synagogue. Pendant des années, Boris Cyrulnik a été persuadé que ce militaire avait vu le petit garçon mais qu’il n’avait rien dit pour ne pas le dénoncer – par humanité. Ce n’est que plus tard qu’il apprendra la vérité crue : le "soldat bienveillant" n’a en réalité pas vu l’enfant mais, tombant sur la femme mourante, il lui a lancé : "Qu’elle crève ici ou ailleurs, ce qui compte c’est qu’elle crève". Tout se passe comme si la mémoire du jeune enfant avait reconstruit un souvenir afin de rendre son passé plus supportable. Sa santé psychique était sans doute à ce prix.
Même s’il est peu abordé au cours de cette séance, l’oubli fait partie de nos capacités cognitives : "Il est possible de vivre presque sans souvenir et de vivre heureux, comme le démontre l'animal, mais il est impossible de vivre sans oublier" affirme Nietzsche. Plus tard, Sigmund Freud a démontré que l’oubli est indispensable pour rendre notre vie psychique saine et stable. Parmi ces oublis, étudiés par le plus célèbre des psychanalystes, figurent en bonne place les actes manqués et les lapsus.
Parler de mémoire, dit Jean-Dominique Paoli, c’est avoir en tête que sa compréhension est relativement récente. Pendant très longtemps, son étude s’est cantonnée aux réflexions de philosophes (Cicéron, s. Augustin ou Malebranche pour ne citer qu’eux). Est-ce à dire que cette faculté a été déconsidérée ? Non : pendant des centaines d’années, l’ars memoriae faisait partie des matières enseignées sous l’Antiquité (chez Platon ou Cicéron par exemple, cf. cet extrait de texte de Platon) comme sous l’époque médiévale (pour aller plus loin, lire ce document en ligne).

Depuis trente ans environ, l’arrivée et le développement de l’imagerie médicale (nombre de personnes se souviennent de l’événement que constituait il y a quelques années l’investissement dans tel ou tel hôpital d’un appareil IRM) a bouleversé notre connaissance du cerveau. Aujourd’hui, il est possible de suivre en temps réel l’activité du cerveau, ce qui laisse augurer pour les années à venir des progrès fulgurants dans la connaissance de cet organe hors du commun.
Qu’est-ce que la mémoire ? Blaise Pascal résume en disant qu’"elle est nécessaire à toutes les opérations de l’esprit". Et pas seulement de l’esprit : elle régit notre motricité ("Les jambes, les bras sont pleins de souvenirs engourdis" dit Marcel Proust) autant que nos capacités cognitives, y compris celles les plus enfouies. D’emblée, pour un tel sujet, on se situe dans un vocabulaire en miroir :
Mémoire / cerveau
|
Psychisme / physiologique
|
Conscient / inconscient
La mémoire à court terme est chargée de trier des informations provenant des cinq sens : visuelles, auditives, olfactives, gustatives et tactiles. Ce tri est constant et quasi instantané. Sans cesse renouvelé, il est nécessaire au bon fonctionnement de notre psychisme. J’ai un numéro de téléphone à composer. Mon cerveau enregistre ce numéro momentanément. À peine tapé au clavier, j’ai déjà oublié ce numéro, du moins si sa mémorisation ne m’est pas utile. C’est l’hippocampe qui gère ce tri et qui procède soit à l’élimination, soit à la conservation de cette information. Dans ce cas, celle-ci est en quelque sorte étiquetée et rangée à l’intérieur de mon cerveau pour une éventuelle réutilisation.
Qui décide du tri ? En principe, dit encore Jean-Dominique Paoli, l’inconscient décide de ce qui doit être éliminé ; le conscient décide de son côté ce que l’on doit conserver dans la mémoire à long terme.
Il y a cependant une nuance de taille : l’inconscient peut décider seul de conserver l’information lorsqu’elle s’accompagne d’une émotion. L’amygdale, structure par laquelle toutes les émotions passent, donne alors une injonction à l’hippocampe. L’inconscient joue son rôle à plein, au point que la personne ignore cette conservation d’information.
Ce n’est que fortuitement que ce souvenir pourra se réveiller et se révéler à la personne. Claire cite Henri Bergson, théoricien de la mémoire involontaire : "La mémoire (...) n’est pas une faculté de classer des souvenirs dans un tiroir ou de les inscrire sur un registre... En réalité le passé se conserve de lui-même, automatiquement."
Mais, ajoute notre invité, qui mieux que Marcel Proust a parlé de notre mémoire dans son œuvre fleuve À la Recherche du Temps perdu ? La "madeleine de Proust" est l’exemple parfait pour parler de cette procédure mentale de mémoire involontaire :
"Et tout d'un coup le souvenir m'est apparu. Ce goût c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray (parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe), quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté ; peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents ; peut-être parce que de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé ; les formes - et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel, sous son plissage sévère et dévot - s'étaient abolies, ou ensommeillées, avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir." (Proust, Du côté de chez Swann, 1913)
Ce célèbre texte lu par Bruno rend compte de manière admirable comment un souvenir peut rester à jamais enfoui dans la mémoire si rien ne vient le réveiller.
 Un aspect important à souligner est encore le rôle de la mémoire dans la compréhension du langage. La mémoire à court terme permet de mémoriser le début d’une phrase de manière à ce que l’on en comprenne la fin.
Un aspect important à souligner est encore le rôle de la mémoire dans la compréhension du langage. La mémoire à court terme permet de mémoriser le début d’une phrase de manière à ce que l’on en comprenne la fin.
En fin de compte, que deviennent ces informations une fois stockées ? Nous avons dit qu’elles pouvaient passer dans la mémoire à long terme soit grâce à un acte conscient de la mémorisation, soit suite à une procédure inconsciente en présence d’une émotion. Elles peuvent aussi disparaître purement et simplement. Toutefois, on pourra les retrouver en reconstituant le contexte. Là encore, la notion de tri est centrale car il faut laisser la place aux millions d’informations qui assaillent la mémoire à court terme.
S’agissant des petits troubles de la mémoire, faut-il s’en inquiéter ? Où sont mes clés ? Mes lunettes ? Que suis-je venu faire dans cette pièce ? Si je refais le chemin géographique, trouverai-je la réponse ? Rien n’est moins sûr… Suis-je en train de perdre la mémoire ? C’est grave, docteur ? Ce sont autant de situations – les plaintes mnésiques – qui inquiètent. Il convient de se rassurer : les professionnels consultés au sujet de la mémoire considèrent que tant qu’il y a plainte mnésique il n’y a pas de réel problème puisque la personne est consciente de ses défaillances.
Ces oublis, certes gênants dans la vie quotidienne, ne sont que des problèmes mineurs liés au fonctionnement de la mémoire à court terme d’une part et à un manque de concentration et à des gestes machinaux d’autre part : lorsque l’on pose ses clés, un geste machinal, la mémoire à court terme élimine l’information dans les secondes qui suivent. Cela n’a a priori pas de rapport avec une maladie neurodégénérative.
À ce stade du débat et après près d’une heure d’explication, Bruno propose de mettre Jean-Dominique Paoli à l’épreuve. Les participants avaient en début de séance listé 20 noms de philosophes. Ces noms, Jean-Dominique parvient devant le public à les retrouver, qui plus est dans l’ordre où ils ont été donnés :
Nietzsche (n°1), Platon (n°2), Spinoza (n°3), Bergson (n°4), Kierkegaard (n°5), Schopenhauer (n°6), Descartes (n°7), Lavarède (n°8), Pascal (n°9), Kant (n°10), Teilhard de Chardin (n°11), Épicure (n°12), Sartre (n°13), Husserl (n°14), Socrate (n°15), Confucius (n°16), Alain (n°17), Marx (n°18), Montaigne (n°19), Lao Tseu (n°20).
Il a suffi d’une poignée de minutes à notre invité pour mémoriser – dans l’ordre et sans avoir cessé son intervention ! – cette liste ardue, composée qui plus de noms peu courants. Ce travail de mémorisation s’appuie sur des aides mnémotechniques : des personnages facilement identifiables (les Chinois Confucius ou Lao Tseu ou bien encore Montaigne, le plus célèbre des Bordelais), de noms mis en scène ("Platon assiste à un banquet"), d’anecdotes sur tel ou tel personnage (Nietzsche, ses relations avec Richard Wagner et le dévoiement de certaines de ses théories – le Surhomme – récupérées par l’idéologie nazie) ou de jeux de mots (chope-> Schopenhauer !)... N’oublions pas que le cerveau n’aime rien de mieux que le politiquement incorrect ! L’intervenant précise l’importance, à la condition d’être en état de relâchement, du travail de son inconscient, lequel a enregistré les informations en arrière-plan et les restitue de manière quasi automatique. (Claire et Bruno témoignent d’ailleurs que bien après cette séance, jusqu’à trois jours plus tard, cette liste a pu être récitée parfaitement par notre intervenant, la mémoire s’étant consolidée).
 Jean-Dominique Paoli tient à montrer que cette performance n'est pas exceptionnelle et que tout un chacun peut parvenir à entraîner sa mémoire de la même façon. Une condition essentielle est d’adopter un mode de vie saine, en incluant le sport (la marche quotidienne pour notre invité) et en excluant drogues et alcool. Celui-ci insiste également sur une autre notion, que viennent corroborer plusieurs participants du public (dont un médecin) : l’importance du lâcher prise que nos sociétés contemporaines tendent à gommer. L’utilisation de plus en plus fréquente de la sophrologie – si elle est bien pratiquée par des personnes compétentes et qualifiées – peut être un outil intéressant d’aide à ce lâcher prise. (pour en savoir plus, rendez-vous sur cette page consacrée à la sophrologie). Il existe enfin des procédés mnémotechniques connus et facilement trouvables sur l’Internet.
Jean-Dominique Paoli tient à montrer que cette performance n'est pas exceptionnelle et que tout un chacun peut parvenir à entraîner sa mémoire de la même façon. Une condition essentielle est d’adopter un mode de vie saine, en incluant le sport (la marche quotidienne pour notre invité) et en excluant drogues et alcool. Celui-ci insiste également sur une autre notion, que viennent corroborer plusieurs participants du public (dont un médecin) : l’importance du lâcher prise que nos sociétés contemporaines tendent à gommer. L’utilisation de plus en plus fréquente de la sophrologie – si elle est bien pratiquée par des personnes compétentes et qualifiées – peut être un outil intéressant d’aide à ce lâcher prise. (pour en savoir plus, rendez-vous sur cette page consacrée à la sophrologie). Il existe enfin des procédés mnémotechniques connus et facilement trouvables sur l’Internet.
La séance se termine par la communication de l’adresse mail de Jean-Dominique Paoli. Il se déclare prêt à renseigner les personnes qui sont intéressées. Claire et Bruno le remercient une nouvelle fois pour son intervention brillante au cours de cette séance spéciale du café philosophique qui aura été, pour l’occasion, moins riche en débat mais particulièrement instructive.
Claire et Bruno fixent rendez-vous pour le prochain débat qui aura lieu le 21 décembre 2012. Des mouvements apocalyptiques ayant fixé la fin du monde à cette date, ce n’est pas sans malice que le café philosophique de Montargis a choisi de consacrer sa prochaine séance à ce sujet : "Catastrophe ! La fin du monde ? La peur peut-elle être bonne conseillère ?" Il ne reste plus qu’à espérer, conclut Bruno, que ce jour-là nous serons suffisamment de survivants – et nous le fêterons devant un verre ! – pour mener notre débat sur ce sentiment ancestral et universel qu’est la peur…
Pour aller plus loin dans ce débat, lire aussi l'interview de Jean-Dominique Paoli.
Pour en savoir plus sur la mémoire, voir cette bibliographie
Photos de Bernard Croissant, avec son aimable autorisation