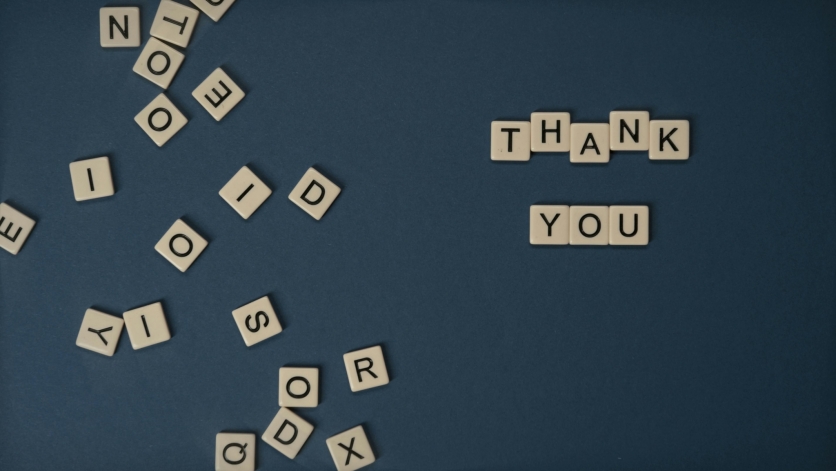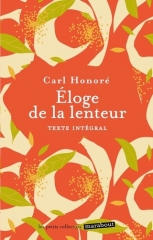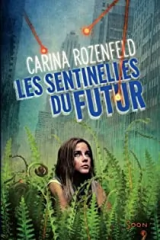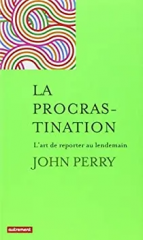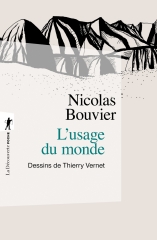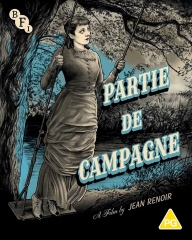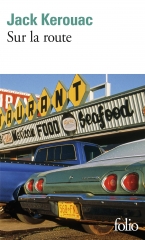Café philo janvier 2025
Bergson : Philosophie et art

La philosophie n'est pas l'art, mais elle a avec l'art de profondes affinités. Qu'est-ce que l'artiste ? C'est un homme qui voit mieux que les autres car il regarde la réalité nue et sans voiles. Voir avec des yeux de peintre, c'est voir mieux que le commun des mortels. Lorsque nous regardons un objet, d'habitude, nous ne le voyons pas; parce que ce que nous voyons, ce sont des conventions interposées entre l'objet et nous ; ce que nous voyons, ce sont des signes conventionnels qui nous permettent de reconnaître l'objet et de le distinguer pratiquement d'un autre, pour la commodité de la vie. Mais celui qui mettra le feu à toutes ces conventions, celui qui méprisera l'usage pratique et les commodités de la vie et s'efforcera de voir directement la réalité même, sans rien interposer entre elle et lui, celui-là sera un artiste. Mais ce sera aussi un philosophe, avec cette différence que la philosophie s'adresse moins aux objets extérieurs qu'à la vie intérieure de l'âme.
Henri Bergson, "Conférence de Madrid sur l'âme humaine" , in Mélanges (1885-1892)
Photo : Pexels - Jose Antonio Gallego Vázquez