Thème du débat : "Un bon artiste est-il le Surhomme ?"
Date : 29 novembre 2013 à l'AGART d'Amilly.
Le 29 novembre 2013, le café philosophique de Montargis (qui, exceptionnellement, devrait plutôt s’appeler "Café philosophique d’Amilly") se décentralisait à la galerie d’art d’Amilly l’AGART pour un sujet intitulé "Un bon artiste est-il le Surhomme ?" Cette séance se déroulait au milieu de l’exposition "Recouvrement", constituée d'oeuvres de Marcel Dupertuis, Claudie Laks et Ernesto Riveiro.
Le premier point qui est posé est celui de cette définition du Surhomme. De quoi parle-t-on ? d’un "Superman" ou d’un "James Bond" pour reprendre les réflexions d’Umberto Eco dans son essai De Superman au Surhomme (cf. cet article) ? Ce concept de Surhomme est en réalité emprunté à Nietzsche (Übermensch). Pour une première participante, ce terme de "Surhomme" est troublant car il a historiquement subi les avanies de l’Histoire – on pense, évidemment et hélas, au Nazisme, qui a récupéré et instrumentalisé ce mot. Qui dit Surhomme, ajoute cette participante, dit hiérarchie entre les hommes. C’est par là même considérer qu’il y a des "sur hommes" et des "hommes inférieurs". Et si l’on se place sur le terrain de l’art, parler de Surhomme c’est nier les capacités artistiques de tout un chacun.
Pour une autre intervenante, le Surhomme n’est pas à voir comme un individu au-dessus de la mêlée, dominateur et conquérant, mais comme une personne "enveloppant" ses contemporains. L’artiste pourrait être celui ou celle s’entourant de l’art pour exister. L’artiste a une vision différente, dit un nouveau participant, qu’il exprime au travers d’un médium qui peut aussi bien être la peinture, la sculpture, la musique, la littérature ou le cinéma. Car au centre de la définition de l’artiste, il y a d’abord la création d’une œuvre d’art.
 Dans notre inconscient, de quoi parle-t-on lorsque l’on évoque le terme Surhomme ? Sans doute d’invocation, d’un pouvoir de surpassement quasi divin. Tel un "fakir", l’artiste aurait reçu un don quasi mystique qu’il peut maîtriser. Il est patent, dit une participante, que la découverte des arts premiers soit aussi celle de créations en rapport avec des religions, voire à des fonctions magiques. Bruno cite à ce sujet Piet Mondrian : "L'art étant surhumain, il cultive l'élément surhumain en l'homme et se trouve être, par conséquent, un moyen d'évolution de l'humanité au même titre que la religion". Un participant réagit ainsi : "Ce qui est magique c’est ce que l’on n’attendait pas." Or, il apparaît qu’il y a bien de la rationalité dans ces créations transcendantes. Au XXe siècle, le Cubisme, invention ahurissante à l’époque, n’est jamais que le fruit d’un travail et de réflexions. "C’est un jeu de l’esprit et de la sensibilité" poussé en profondeur.
Dans notre inconscient, de quoi parle-t-on lorsque l’on évoque le terme Surhomme ? Sans doute d’invocation, d’un pouvoir de surpassement quasi divin. Tel un "fakir", l’artiste aurait reçu un don quasi mystique qu’il peut maîtriser. Il est patent, dit une participante, que la découverte des arts premiers soit aussi celle de créations en rapport avec des religions, voire à des fonctions magiques. Bruno cite à ce sujet Piet Mondrian : "L'art étant surhumain, il cultive l'élément surhumain en l'homme et se trouve être, par conséquent, un moyen d'évolution de l'humanité au même titre que la religion". Un participant réagit ainsi : "Ce qui est magique c’est ce que l’on n’attendait pas." Or, il apparaît qu’il y a bien de la rationalité dans ces créations transcendantes. Au XXe siècle, le Cubisme, invention ahurissante à l’époque, n’est jamais que le fruit d’un travail et de réflexions. "C’est un jeu de l’esprit et de la sensibilité" poussé en profondeur.
Dans les propos nietzschéens, il n’y a pas l’idée que le Surhomme vient écraser les autres. Il est d’abord question d’un dépassement. Par ailleurs, et pour reprendre les propos d’Henri Bergson, les artistes savent s’extraire de la réalité pour la voir autrement. En quelque sorte, ils bâtissent un monde entre la nature et la culture et élèvent l’Humanité. En cela ils peuvent être définis comme des Surhommes. Ce surpassement, est-il dit, ne doit pas être l’apanage des seuls créateurs. Chacun a la possibilité, dans la mesure de ses capacités, de devenir ce Surhomme nietzschéen.
![IMG_2750[1].jpg](http://cafephilosophique-montargis.hautetfort.com/media/01/01/3749281380.jpg) Quelle est la finalité esthétique de l’artiste, s’interroge Claire ? Il a été dit que ce qui se joue est d’abord la création d’une œuvre. Cela étant, l’artiste voit-il la réalité différemment du "commun des mortels" ? Est-il "doué" d’un don que le commun des mortels n’a pas et qu’il aurait su exploiter et travailler ? Mozart écrivait d’ailleurs ceci : "Quand je me sens bien et que je suis de bonne humeur […], les pensées me viennent en foule et le plus aisément du monde. D’où et comment m’arrivent-elles ? Je n’en sais rien, je n’y suis pour rien." Il y a cette idée que quelque part l’artiste le devient comme une évidence, par vocation ou, mieux, par orientation.
Quelle est la finalité esthétique de l’artiste, s’interroge Claire ? Il a été dit que ce qui se joue est d’abord la création d’une œuvre. Cela étant, l’artiste voit-il la réalité différemment du "commun des mortels" ? Est-il "doué" d’un don que le commun des mortels n’a pas et qu’il aurait su exploiter et travailler ? Mozart écrivait d’ailleurs ceci : "Quand je me sens bien et que je suis de bonne humeur […], les pensées me viennent en foule et le plus aisément du monde. D’où et comment m’arrivent-elles ? Je n’en sais rien, je n’y suis pour rien." Il y a cette idée que quelque part l’artiste le devient comme une évidence, par vocation ou, mieux, par orientation.
Si l’on parle du don quasi divin reçu par tel ou tel créateur, il ne faudrait pas oublier la place du travail, de l’éveil et de la culture de ce don. Mozart peut bien mettre en valeur la source mystérieuse de son talent, les œuvres naissent en général à la sueur du front. Ainsi, Serge Gainsbourg avait beau présenter ses musiques comme "des œuvres mineures", sorties ex nihilo, il s’avère en réalité que ses plus grandes chansons (Initials BB, notamment. Cf. ce lien) étaient travaillées de manière extrêmement rigoureuses. Une œuvre est souvent un long cheminement, qui n’a rien à voir avec une démarche merveilleuse ou divine.
Un artiste présent dans la salle réagit : finalement, n’est-ce pas la société qui souhaite voir tel ou tel musicien, plasticien ou cinéaste comme un "être d’exception" ? Le respect pour l’artiste est certes indéniable dans nos sociétés. Dans le même temps, elle souhaite aussi qu’il n’y en ait pas trop ! Le marché de l’art est dans la même posture, cette fois pour des raisons économiques. De grandes créations sont considérées par de nombreux investisseurs comme des marchandises et des placements, au même titre que des actions ou des immeubles. L’artiste, qu’il soit célèbre ou au contraire anonyme, peut considérer que son supplément d’âme le place au-dessus du commun des mortels. La société lui renvoie et lui inspire cette idée que le créateur a une mission qui le transcende, au point qu’il doit être détaché des contingences matérielles. Établir une comptabilité pour la gestion de son atelier d’artiste, par exemple, a été longtemps considéré par des artistes comme une aberration. Ce n’est plus vrai aujourd’hui, pour le meilleur mais aussi pour le pire. L’économie et l’argent sont omniprésents dans le domaine de l’art. Des créations sont mercantilisées parfois jusqu’à l’absurde : une œuvre de Vincent Van Gogh est de nos jours vendue à des prix astronomiques alors que l’artiste a été ignorée à son époque et est mort pauvre et seul. La finance a un pouvoir délétère sur les créations, commente une intervenante, au point que l’artiste peut être parfois considéré comme un "sous-homme". L’art, longtemps considéré comme gratuit, se trouve "dévalorisé" par l’argent, par ventes aux enchères et par des grands salons d’art contemporain – FIAC ou autres. Les œuvres sont devenues des marchandises part entière et des artistes sont devenus des marques (Jeff Koons), étouffant par ailleurs toute forme de différence. Certes, le côté mercantile est bien présent, réagit Claire, mais cet aspect est loin d’être prégnant dans cette exposition "Recouvrement" de l’AGART, au milieu de laquelle se déroule cette séance du café philosophique de Montargis !
 Comment pourrait-on définir un bon artiste ? Un participant suggère que le bon artiste pourrait s’apparenter au "bon sauvage" de Rousseau. Pour un autre intervenant, le bon artiste pourrait être celui qui aurait trouvé son bon mode d’expression, au point de le sublimer. Pour une participante, un artiste suscite la rencontre, à une certaine époque, entre une émotion artistique et un talent. Vecteur de pensées positives – si tant est que l’émotion peut être positive. L’artiste doit respecter ses brillants prédécesseurs, dit une participante, sans pour autant les ménager car sans cela il n’y aurait pas d’impulsion dans l’art nouveau. Les vrais et bons artistes sont rares. Ce sont ceux qui vont nous amener vers une autre dimension que la condition humaine. Ce sont aussi ceux qui s’extraient de la tentation de créer dans la virtuosité pure – dit autrement : "faire du tapage" – pour proposer une œuvre d’art "consistante" – un "fond". L’artiste ne serait-il pas celui qui créé grâce à l’expression de soi ? Cette expression passe par un langage unique et différent qui interroge le public, voire le fait rêver.
Comment pourrait-on définir un bon artiste ? Un participant suggère que le bon artiste pourrait s’apparenter au "bon sauvage" de Rousseau. Pour un autre intervenant, le bon artiste pourrait être celui qui aurait trouvé son bon mode d’expression, au point de le sublimer. Pour une participante, un artiste suscite la rencontre, à une certaine époque, entre une émotion artistique et un talent. Vecteur de pensées positives – si tant est que l’émotion peut être positive. L’artiste doit respecter ses brillants prédécesseurs, dit une participante, sans pour autant les ménager car sans cela il n’y aurait pas d’impulsion dans l’art nouveau. Les vrais et bons artistes sont rares. Ce sont ceux qui vont nous amener vers une autre dimension que la condition humaine. Ce sont aussi ceux qui s’extraient de la tentation de créer dans la virtuosité pure – dit autrement : "faire du tapage" – pour proposer une œuvre d’art "consistante" – un "fond". L’artiste ne serait-il pas celui qui créé grâce à l’expression de soi ? Cette expression passe par un langage unique et différent qui interroge le public, voire le fait rêver.
L’autre question à se poser, dit Claire, c’est si l’artiste a un message à transmettre. Dit autrement, en quoi telle ou telle création apporte quelque chose d’inédit. Le surnaturel n’a rien à voir là-dedans : on découvre quelque chose que l’on ne connaissait pas, qui est le fruit d’un travail. Et ce message, cette invention, n’est pas souvent facile à décrypter : il faut parfois un "mode d’emploi" et être "éduqué".
S’il peut paraître aisé "d’entrer dans certaines œuvres" (un tableau de Vinci ou un concerto de Mozart), la chose peut est moins aisé pour d’autres créations : la musique dodécaphonique ou un tableau de Francis Bacon. Or, la compréhension peut être affaire de temps : tel ou tel va être hermétique à un livre ou un film à un certain âge puis va y être réceptif quelques années plus tard. Les jeunes enfants, hypersensibles sans préjugés, sont un modèle, dit une participante, en ce qu’ils parviennent à approcher des œuvres d’art avec souvent intérêt et clairvoyance.
 Que recouvre l’art au final ? Peut-on dire qu’un cuisinier est un artiste ? Cette question posée par une participante rejoint, dit Bruno, une autre question beaucoup plus large : celle de la différence entre artiste et artisan, bien que ces deux mots viennent du même terme "art" – technè. Un cuisinier est un artisan, dans le sens où c’est une personne qui créé quelque chose – un plat, une assiette, etc. – qui peut être esthétique, mais avec une vocation utilitaire. L’artisan produit et surtout reproduit. Pour Platon (La République), l’artisan est digne de vivre dans la Cité alors que l’artiste ne sert à rien. Ses créations sont vaines dans le sens où il fait une imitation de la nature qui est elle-même une imitation du monde des Idées. L’art est la production du beau qui doit être inutile, dans le sens économique du terme. L’artiste est finalement une invention moderne (La Renaissance). Leonard de Vinci était certainement avant tout scientifique et artisan. Ce n’est qu’au XVIIIe siècle que la distinction artiste/artisan apparaît. Un peu plus tard, ajoute une intervenante, survient la première Révolution industrielle. À partir de ce moment, l’assiette de l’artisan peut être produite à grande échelle et l’art entre dans une nouvelle échelle, jusqu’à être légiférée.
Que recouvre l’art au final ? Peut-on dire qu’un cuisinier est un artiste ? Cette question posée par une participante rejoint, dit Bruno, une autre question beaucoup plus large : celle de la différence entre artiste et artisan, bien que ces deux mots viennent du même terme "art" – technè. Un cuisinier est un artisan, dans le sens où c’est une personne qui créé quelque chose – un plat, une assiette, etc. – qui peut être esthétique, mais avec une vocation utilitaire. L’artisan produit et surtout reproduit. Pour Platon (La République), l’artisan est digne de vivre dans la Cité alors que l’artiste ne sert à rien. Ses créations sont vaines dans le sens où il fait une imitation de la nature qui est elle-même une imitation du monde des Idées. L’art est la production du beau qui doit être inutile, dans le sens économique du terme. L’artiste est finalement une invention moderne (La Renaissance). Leonard de Vinci était certainement avant tout scientifique et artisan. Ce n’est qu’au XVIIIe siècle que la distinction artiste/artisan apparaît. Un peu plus tard, ajoute une intervenante, survient la première Révolution industrielle. À partir de ce moment, l’assiette de l’artisan peut être produite à grande échelle et l’art entre dans une nouvelle échelle, jusqu’à être légiférée.
Chez Platon, précise Claire, il y a une réelle ambivalence : une république idéale a des problèmes avec les artistes considérés comme peu utiles. Dans le même temps, les œuvres sans finalité esthétique, sans fonction économique ou sociale, doivent être distinguées car elles posent problème. Elles sont certes le fruit de la Muse : il y a un rapport avec les dieux, Hermès ou l’herméneutique. L’artiste est celui qui favorise l’épitunia. Cependant, dans une cité qui doit se tenir débout, l’artiste n’a pas sa place, ajoute le philosophe antique. La gratuité littérale de l’art pose problème pour Platon. "C'est chose légère que le poète, ailée, sacrée: il n'est pas en état de créer avant d'être inspiré par un dieu, hors de lui, et de n'avoir plus sa raison; tant qu'il garde cette faculté, tout être humain est incapable de faire oeuvre poétique et de chanter des oracles", écrivait-il.
 En s’intéressant à cette ambivalence platonicienne, le public du café philosophique de Montargis (ou, plutôt, pour ce soir, "d’Amilly" !) s’interroge sur la fonction "d’utilité" que l’on prête ou non à l’art. Un participant souligne qu’au XIXe siècle nombreux étaient ceux qui estimaient que le peuple avait autant besoin de pain que d’art. "L’art sauvera le monde" disait Fiodor Dostoïevski ! Le terme "utile" est à voir ici dans le sens salvateur du terme, répond Claire. La distinction entre besoin et désir, entre les besoins naturels et ceux qui ne le seraient pas – et donc considérés comme vains – est en réalité caduque. Un chef cuisinier transcende d’ailleurs cette différence entre art et artisanat. Si être homme c’est se tenir debout, comme le disait Alain, sans l’art on le peut difficilement. Il est dit que les œuvres des arts premiers avaient une fonction religieuse, voire magique. Que l’on pense au premier vers d’Homère dans L’Iliade : "Muse, chante la colère du fils de Pélée." Il y a aussi une question ethnologique dans l’appréhension dans ces arts.
En s’intéressant à cette ambivalence platonicienne, le public du café philosophique de Montargis (ou, plutôt, pour ce soir, "d’Amilly" !) s’interroge sur la fonction "d’utilité" que l’on prête ou non à l’art. Un participant souligne qu’au XIXe siècle nombreux étaient ceux qui estimaient que le peuple avait autant besoin de pain que d’art. "L’art sauvera le monde" disait Fiodor Dostoïevski ! Le terme "utile" est à voir ici dans le sens salvateur du terme, répond Claire. La distinction entre besoin et désir, entre les besoins naturels et ceux qui ne le seraient pas – et donc considérés comme vains – est en réalité caduque. Un chef cuisinier transcende d’ailleurs cette différence entre art et artisanat. Si être homme c’est se tenir debout, comme le disait Alain, sans l’art on le peut difficilement. Il est dit que les œuvres des arts premiers avaient une fonction religieuse, voire magique. Que l’on pense au premier vers d’Homère dans L’Iliade : "Muse, chante la colère du fils de Pélée." Il y a aussi une question ethnologique dans l’appréhension dans ces arts.
La notion de beauté est brièvement débattue. Autant le classicisme et l’académisme a mis cette notion au centre de toute production artistique, autant aux XX et XXIe siècles ce concept n’est généralement pas la préoccupation première des artistes (le Fluxus dans les arts plastiques, le réalisme au cinéma, le Nouveau Roman en littérature ou le sérialisme en musique contemporaine). Parler de canons de beauté c’est établir un constat de subjectivité, du moins depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Pour autant, cette notion de beauté aurait tendance à revenir.
La notion de temps joue : l’époque qui accueille l’artiste – en bien, en mal ou pas du tout – mais aussi l’époque ou les époques qui influencent l’artiste. L’artiste est "artiste dans la Cité". En musique contemporaine, les mouvements d’avant-garde, le dodécaphonisme sériel pour ne citer que celui-ci, ont été créés en réaction à des mouvements antérieurs – le classicisme et le romantisme.
 Cette idée de rupture peut se rapprocher, dit Bruno, avec celle de Surhomme nietzschéen. Le point de départ de ce concept est cette notion émise par le "philosophe au marteau" : "Dieu est mort". Avec la fin de cette puissance, sa créature, l’homme, se trouve sans créateur. Esseulée. Privé d’une chimère qu’il invoquait pendant des siècles, l’être humain n’aurait d’autre choix que de s’affirmer lui-même, librement. Il doit reprendre en main sa propre vie ("Devenir celui qu’il est."), se transformant pour le coup en Surhomme. Il n’est donc pas question ici de "super homme", de "Superman" ou de "James Bond" mais de dépassement individuel, à la manière d’un ermite éloigné de ses contemporains, tel Zarathoustra. C’est le sage qui trouve sa propre voie dans le monde, après s’être libéré des chaînes d’un maître omnipotent et chimérique : "Je vous enseigne le Surhumain. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté." Le Surhomme étant pour Nietzsche le stade supérieur de l’homme comme l’homme l’est par rapport au singe, ajoute le philosophe ("Qu'est-ce que le singe pour l'homme ? Un objet de risée ou une honte douloureuse. Et c'est exactement cela que l'homme doit être pour le surhumain : un objet de risée ou une honte douloureuse"). L’artiste en tant que Surhomme n’est pas au-dessus des hommes dans une position hiérarchique – et verticale – mais celui qui est à côté, tel le célèbre ermite Zarathoustra.
Cette idée de rupture peut se rapprocher, dit Bruno, avec celle de Surhomme nietzschéen. Le point de départ de ce concept est cette notion émise par le "philosophe au marteau" : "Dieu est mort". Avec la fin de cette puissance, sa créature, l’homme, se trouve sans créateur. Esseulée. Privé d’une chimère qu’il invoquait pendant des siècles, l’être humain n’aurait d’autre choix que de s’affirmer lui-même, librement. Il doit reprendre en main sa propre vie ("Devenir celui qu’il est."), se transformant pour le coup en Surhomme. Il n’est donc pas question ici de "super homme", de "Superman" ou de "James Bond" mais de dépassement individuel, à la manière d’un ermite éloigné de ses contemporains, tel Zarathoustra. C’est le sage qui trouve sa propre voie dans le monde, après s’être libéré des chaînes d’un maître omnipotent et chimérique : "Je vous enseigne le Surhumain. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté." Le Surhomme étant pour Nietzsche le stade supérieur de l’homme comme l’homme l’est par rapport au singe, ajoute le philosophe ("Qu'est-ce que le singe pour l'homme ? Un objet de risée ou une honte douloureuse. Et c'est exactement cela que l'homme doit être pour le surhumain : un objet de risée ou une honte douloureuse"). L’artiste en tant que Surhomme n’est pas au-dessus des hommes dans une position hiérarchique – et verticale – mais celui qui est à côté, tel le célèbre ermite Zarathoustra.
Chacun a vocation à devenir Surhomme, précise Claire. Nous avons "à bosser... à ne pas rester paresseux" afin d’aspirer à cette condition. Dans Ainsi Parlait Zarathoustra, ce sont les autres les imbéciles, ceux qui ne voient pas et qui n’y aspirent pas. Pour Nietzsche , ajoute Bruno, le Surhomme n’existe (toujours) pas. En revanche, dans l’Histoire de l’Humanité, certains hommes se sont rapprochés de cet idéal : Goethe, Vinci et Shakespeare. Tous des artistes !
 Être dans le monde est la qualité première de l’artiste qui traite des problématiques de l’époque, qu’il soit en avance ou en retard sur celle-ci. Ainsi, l’Impressionnisme est un mouvement qui a touché l’ensemble d’une génération. Une époque retiendra ou non tel ou tel artiste. L’acte créateur comme un acte inspiré doit être démystifié, affirme un membre de l’assistance, dans le sens où c’est sous le prisme social que doit être compris le geste artistique. Il n’y a certes plus de courants esthétiques au XXIe siècle, comme ont pu exister le Romantisme, l’Impressionnisme ou le Cubisme, mais cette problématique de l’artiste comme d’un être de son époque reste valable. Ce qui ne veut pas dire qu’une œuvre d’art ne transcende pas les époques : les arts premiers mettent la lumière sur des créations anciennes d’autres civilisations (le Musée du Quai Branly, par exemple) que l’on "découvre" (littéralement "enlever une couverture").
Être dans le monde est la qualité première de l’artiste qui traite des problématiques de l’époque, qu’il soit en avance ou en retard sur celle-ci. Ainsi, l’Impressionnisme est un mouvement qui a touché l’ensemble d’une génération. Une époque retiendra ou non tel ou tel artiste. L’acte créateur comme un acte inspiré doit être démystifié, affirme un membre de l’assistance, dans le sens où c’est sous le prisme social que doit être compris le geste artistique. Il n’y a certes plus de courants esthétiques au XXIe siècle, comme ont pu exister le Romantisme, l’Impressionnisme ou le Cubisme, mais cette problématique de l’artiste comme d’un être de son époque reste valable. Ce qui ne veut pas dire qu’une œuvre d’art ne transcende pas les époques : les arts premiers mettent la lumière sur des créations anciennes d’autres civilisations (le Musée du Quai Branly, par exemple) que l’on "découvre" (littéralement "enlever une couverture").
Il est affirmé au cours de cette séance que le bon artiste parvient à transcender sa position le citoyen tel qu’il est. Comme le cite une intervenante et artiste, "L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art" (Robert Filliou). Tel le Surhomme nietzschéen, l’artiste est au milieu de ses contemporains – qui peuvent être son public – mais en tant qu’être unique, souvent solitaire dans sa création, il trace une route unique, construit un univers autonome, à qui la société donne une certaine valeur – qu’elle soit marchande ou non. L’artiste voit différemment. Il transmet sa vision que le spectateur, le lecteur ou l’auditeur peut comprendre ou non. Pour Hegel, l’art est le dépassement de l’humanité, c’est la transcendance, c’est ce qui élève l’homme. L’art c’est partager quelque chose via la matière, la nature. Il y a quelque chose de l’ordre de l’idéal esthétique. C’est dans ce sens que l’artiste est un homme d’exception. Un participant réagit ainsi : ne peut-on pas d’abord parler "d’œuvre d’exception" plutôt que "d’artiste d’exception" ?
 Comment voir cette œuvre d’expression ? Cette question fait débat. Il a été fait référence au langage inédit de tel ou tel artiste pour s’exprimer – comme la littérature passe par les mots. Or, pour comprendre le langage pictural ou musical, il est affirmé que la notion de pédagogie ou d’éducation doivent être mis en avant : "On apprend à lire ; on a jamais appris à lire une peinture !" Encore faudrait-il savoir si l’artiste veut exprimer quelque chose ou s’il n’est pas dans une forme d’autotélisme, ce qui semble être particulièrement vrai dans l’art du XXe siècle. De quel message parlons-nous ? Ne serait-ce pas une forme de "soulagement" et l’expression de sentiments traduits sous le biais de la création. Une jeune participante cite l’œuvre de Ron Mueck "Mon Père", sculpture hyperréaliste et bouleversante évoquant le deuil du père du plasticien. Cette émotion intime devient universelle par la seule force du geste technique (technè) de l’artiste. Elle nous touche et nous fait rêver, avec ou sans éducation. Être touché émotionnellement participe à quelque chose de l’ordre de l’instinct. Jusqu’à faire de cette émotion une nourriture qui va construire l’observateur d’une œuvre d’art, l’auditeur d’un opéra ou le spectateur d’un long-métrage. "L'artiste a le pouvoir de réveiller la force d'agir qui sommeille dans d'autres âmes", disait Nietzsche.
Comment voir cette œuvre d’expression ? Cette question fait débat. Il a été fait référence au langage inédit de tel ou tel artiste pour s’exprimer – comme la littérature passe par les mots. Or, pour comprendre le langage pictural ou musical, il est affirmé que la notion de pédagogie ou d’éducation doivent être mis en avant : "On apprend à lire ; on a jamais appris à lire une peinture !" Encore faudrait-il savoir si l’artiste veut exprimer quelque chose ou s’il n’est pas dans une forme d’autotélisme, ce qui semble être particulièrement vrai dans l’art du XXe siècle. De quel message parlons-nous ? Ne serait-ce pas une forme de "soulagement" et l’expression de sentiments traduits sous le biais de la création. Une jeune participante cite l’œuvre de Ron Mueck "Mon Père", sculpture hyperréaliste et bouleversante évoquant le deuil du père du plasticien. Cette émotion intime devient universelle par la seule force du geste technique (technè) de l’artiste. Elle nous touche et nous fait rêver, avec ou sans éducation. Être touché émotionnellement participe à quelque chose de l’ordre de l’instinct. Jusqu’à faire de cette émotion une nourriture qui va construire l’observateur d’une œuvre d’art, l’auditeur d’un opéra ou le spectateur d’un long-métrage. "L'artiste a le pouvoir de réveiller la force d'agir qui sommeille dans d'autres âmes", disait Nietzsche.
Le bon artiste "Surhomme", sans finalité, sans mission, est celui qui puise en lui ce qu’il a déjà mais différemment des autres pour proposer une "créationdécouverte", si l’on veut faire un néologisme. Il s’inscrit dans une rupture pour susciter un certain éveil en nous.
L’artiste, au contraire de l’artisan dont la vocation est la production et la reproduction, crée une œuvre unique. Il invente. Mais, pour être artiste, sans doute faut-il d’abord être artisan, comme le revendiquaient les artistes du Bauhaus, et ce afin de maîtriser la technè. Dans l’art contemporain, l’intérêt est que les artistes viennent d’univers différents et parviennent ainsi à créer en utilisant des paramètres différents, comme Calder ou Takis. Ils sortent d’un académisme et de critères de lecture figés. Cela a des conséquences sur l’auditeur, le lecteur ou le spectateur : tel(le) ou tel(le) va peut-être rester goguenard devant une œuvre accrochée aux cimaises d’un musée ; mais si cette œuvre est présentée dans un autre lieu, elle suscitera peut-être de l’émerveillement : "Qui saurait reconnaître un Van Gogh dans un poulailler ?" interroge une personne dans l’assistance. L’artiste, nous l’avons dit, doit créer quelque chose d’unique. Partant, il doit aboutir ailleurs, provoquant ainsi des ruptures – jusqu’à la provocation – comme l’art du XXe siècle nous a habitués avec les ruptures académiques et classiques. En cela, l’artiste peut être le Surhomme, cet être libéré des contraintes d’un dieu chimérique et omniscient ("Dieu est mort"). Il trace son chemin au milieu des hommes, ses semblables, tel le sage Zarathoustra en exil permanent.
"Finalement, conclut un participant sous forme de boutade, l’artiste est un surhomme car les 60 premières années sont quand même difficiles !"

En fin de séance, trois sujets sont mis au vote pour le prochain débat : "L’histoire a-t-elle un sens ?", "La raison a-t-elle à s’occuper de l’irrationnel ?", "L’utopie est-elle dénuée de toute valeur ?" C’est ce dernier sujet qui est choisi pour le débat du 10 janvier 2014, qui sera de retour à la Brasserie du centre commercial de la Chaussée.
Philo-galerie
Les illustrations de ce compte-rendu sont tirées de l’exposition "Recouvrement", avec des œuvres de Marcel Dupertuis, Claudie Laks et Ernesto Riveiro.
Retrouvez les photos de cette séance sur ce lien ainsi que sur notre dossier port-folio.








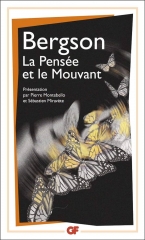






![IMG_2750[1].jpg](http://cafephilosophique-montargis.hautetfort.com/media/01/01/3749281380.jpg)















