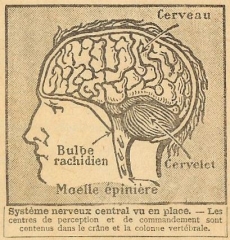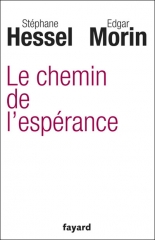Café philo janvier 2025
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE "OSER LA GENTILLESSE"
Thème du débat : "Oser la gentillesse : est-ce encore possible ?"
Date : 1er février 2013 à la Brasserie du Centre commercial de la Chaussée.
Le 1er février 2013, de 75 à 80 personnes étaient invitées à débattre, au cours de cette 29ème séance du café philosophique de Montargis, d’un sujet relativement peu étudié en philosophie : la gentillesse. Ce thème avait été proposé en novembre 2012 par une participante. Pour expliquer cette suggestion, elle estime que la gentillesse, comportement rare et positif, a tendance à se raréfier de nos jours. Il s’agit même, d’après elle, d’une qualité peu mise en valeur voire moquée. Claire interroge l’assistance au sujet de cette attitude à l’altruisme peu en vogue, semble-t-il, de nos jours. "Oser la gentillesse : est-ce encore possible ?" Dit autrement, le gentil est-il ringard?
Un intervenant réagit en s’interrogeant d’emblée sur le qualificatif de "positif" s’agissant de la gentillesse. En est-on si sûrs ? Qu’une telle attitude – être gentil – soit parée de certaines qualités, personne ne le niera ; il n’en reste pas moins que dans la vie sociétale, être gentil n’est pas le nec plus ultra. Dans la vie en entreprise – pour ne prendre que cet exemple – la gentillesse a difficilement sa place. La gentillesse est dans ce milieu une aberration pour ne pas dire une tare. "Être trop gentil" c’est se mettre en état d’infériorité. La vie économique ne fait pas cas des sentiments ni de la morale. Un autre intervenant va dans ce sens : être gentil est une qualité indéniable ; cependant, être gentil partout, tout le temps, n’est pas souhaitable sauf à vouloir être une "victime" perpétuelle. Ce même intervenant considère d’ailleurs que le gentil porte de lourdes responsabilités dans les périodes difficiles de notre Histoire. Les grandes dictatures, dit-il, s’appuient le plus souvent sur l’indolence des gentils pour asseoir leur pouvoir. Le café philosophique avait débattu précédemment sur la question "La vérité est-elle toujours bonne à dire ?" A cette occasion, le débat avait porté sur le "mensonge par humanité" théorisé par Emmanuel Kant. On peut poser une question similaire au sujet de la gentillesse : "La gentillesse est-elle toujours bonne à montrer ?" La réponse semble être a priori : non.
Avant d’aller plus loin, Claire et Bruno proposent de s’intéresser à cette définition de la gentillesse. Comment la définir ? Bonté ? Bienveillance ? Claire reprend une définition du Larousse : "Gentil, ille (adjectif) : Qui manifeste de la bienveillance ; aimable, complaisant". Dans notre imaginaire, le gentil est cet être incongru, brave mais sans intelligence dont on se moque aisément. Il y a par exemple ce terme péjoratif de "gentillet", facilement usité. Paradoxalement, le gentleman, son pendant anglais, serait paré de toutes les qualités : humain, élégant, vertueux, "classieux". Force est de constater, dit encore Claire, que la gentillesse est considérée avec dédain par les philosophes en général. Ce n’est ni une vertu (ou, au mieux, ajoute Bruno, "une petite vertu"), ni une sagesse ni un concept intéressant a priori: le mot "gentillesse" n’apparaît même pas dans le célèbre Dictionnaire vocabulaire technique et philosophique d'André Lalande. En France, un philosophe, Emmanuel Jaffelin, a cependant consacré plusieurs essais sur cette "petite vertu" souvent considérée avec mépris (Éloge de la Gentillesse et Petit Éloge de la Gentillesse, cf. son site Internet : http://gentillesse.blogspot.fr). Pour tout dire, il est difficile de définir exactement la gentillesse, tant le terme nous échappe : bonté ? Bienveillance ? Générosité ? Altruisme ?
Bien que nous ne soyons pas dans un "café historique" mais dans un café philosophique, Bruno souhaite s’arrêter rapidement sur cette histoire du gentil à travers les âges ainsi que sur son étymologie. Le gentil vient à l’origine du mot latin gens qui désignait ces lignées familiales nobles qui possédaient un ancêtre commun. Par la suite, les juifs ont employé le terme de "gentil" ceux qui ne croyaient pas en Yahvé – à ne pas confondre avec les "païens" qui étaient ceux qui croyaient en des dieux qualifiés d’impies. On passe les siècles. Au XVIème siècle, le philosophe humaniste Guillaume Budé invente le terme de "gentilhomme". Il créé ainsi le modèle de l’homme idéal qui est remarquable par ses attitudes et son style de vie. Ce gentilhomme est sensé être le pendant du noble. Ce terme va faire florès. On le retrouve traduit en anglais sous l’appellation de "gentleman". Or, alors que le gentleman continuera longtemps d’être utilisé, notamment dans les pays anglo-saxons, le "gentilhomme" disparaît à partir de la Révolution française de notre société et de notre vocabulaire. Le mot est même dénaturé sous le terme de "gentil". Or, qu’est devenu aujourd’hui ce gentil – ex "gentilhomme" – sinon le gentillet ? Au contraire du gentleman considéré comme respectable et exemplaire, le gentil est "ce (ou cette) brave qui ne peut rien refuser et qui passe tout", au risque de devenir victime de quolibets ou, pire, d’abus : "trop bon, trop con" dit l’expression populaire ! L’un des personnages les plus emblématiques du gentil semble être celui de François Pinon, anti-héros involontaire du Dîner de Cons, interprété magistralement par Jacques Villeret (cf. c lien). On le voit, le terme de "gentil" a subi toutes les avanies au point d’avoir été dévalorisé.
Dévalorisé mais pas rejeté cependant. En effet, depuis 2009, la France adopte la journée de la gentillesse, fixée chaque 13 novembre (http://journee-de-la-gentillesse.psychologies.com). Cette journée est née au Japon sous le terme de "Small Kindness Movement", officialisée en 1998 : voilà donc venue l’heure de la revanche du gentil ! Cette journée s’est symptomatiquement développée en France en 2007, au début du quinquennat d’un Président de la République réputé pour son sens de la pugnacité et de l’égotisme – Nicolas Sarkozy. Il est cocasse d’apprendre, dit Claire, que, comme chaque année, le prix remis au Gentil de l’Année a été décerné en 2012 à… un autre Président de la République : François Hollande. Mais, ça, dit Bruno sous forme de boutade, c’était avant l’intervention militaire de la France au Mali!
Le gentil serait donc, en dépit des qualités qu’on veut bien lui attribuer, cet être en décalage avec notre société obnubilée par la réussite, l’argent et la compétition sous toutes ses formes. Un être considéré, du moins dans notre pays, comme sous-évalué.
En est-on certain ? demande un participant. Des expériences scientifiques menées sur des animaux tendent à prouver que plus la cohésion d’un groupe ethnologique ou éthologique est forte, plus la solidarité y est importante et plus ce groupe voit ses chances de survie s’accroître. L’idée selon laquelle la gentillesse serait un frein à la réussite d’une société ou d’une entreprise économique paraît largement infondée. Une étude, rappelle un nouveau participant, affirme que "Les sociétés qui comptent le plus fort pourcentage de salariés engagés ont collectivement accru leur bénéfice d'exploitation de 19 % et leur bénéfice par action de 28 % d'un exercice à l'autre" (étude du Cabinet Towers Perrin, citation d’Emmanuel Jaffelin, cf. cet article). Être gentil semblerait donc n’être pas une incongruité dans la jungle du monde économique. Tout le monde aurait même à y gagner : dirigeants, actionnaires, salariés, familles de salariés et toute la société ! Bruno cite Woody Allen à ce sujet : "Dans votre ascension professionnelle, soyez toujours très gentil pour ceux que vous dépassez en montant. Vous les retrouverez au même endroit en redescendant."
Un participant intervient pour témoigner sur la difficulté des gentils à assumer parfois leurs comportements : on agit avec altruisme dans telle ou telle situation, sans état d’âme ; savoir qu’on a été ensuite floué, pour ne pas dire trahi, devient douloureux. Dans ce cas, être qualifié de "gentil" prend une notion aussi péjorative que si la personne en face nous avait traité avec condescendance de "gentillet" !
Un intervenant appuie sur la nécessité de faire de la gentillesse une qualité à user avec précaution. L’expérience de Milgram dans les années 60 (une expérience de conditionnement de citoyens ordinaires à infliger de pseudos tortures à l’électricité à des cobayes inconnus) prouve s’il en était que faire de la docilité un style de vie peut être dangereux. De même, la vie en entreprise prouve que savoir dire non est une absolue nécessité pour ne pas devenir victime.
Si l’on parle d’ambition et de compétition – dans le milieu sportif, à l’école, lors de concours, etc. – la gentillesse n’est pas le comportement adéquat non plus. Pour tout dire, non seulement elle n’est pas la bienvenue mais elle est en plus en terre inconnue. Si je participe à une course importante, je n’ai pas à considérer mon adversaire autrement que comme un adversaire à battre. La gentillesse n’a pas son mot à dire. Pour autant, comme le constate un nouveau participant, la compétition sportive n’exclut pas le respect de l’autre et c’est sans doute par le fair-play que la gentillesse se manifeste. Pour aller dans ce sens, Bruno fait référence au Tournoi des VI Nations et à cette fameuse définition du rugby : "Un sport de voyous joué par des gentlemen" !
Claire oriente le débat sur l’intitulé de cette séance : "Oser la gentillesse". "Oser" : ce verbe entendrait montrer qu’être gentil ne va pas de soi, que cela nécessite une forme d’effort. La question est de savoir si cette qualité est naturelle ou bien culturelle. Dit autrement, "l’homme est-il naturellement bon ?" comme l’affirmait Jean-Jacques Rousseau ou bien "l’homme est-il un loup pour l’homme ?" comme l’écrivait au contraire Thomas Hobbes. Il semblerait au vu du débat qui a cours autour de cette question que la culture a un rôle déterminant dans le développement de la gentillesse.
L’un des plus beaux terrains d’observation de cette gentillesse en construction se trouve sur les cours de récréation, durant les premiers âges de la vie. Claire évoque à ce sujet une anecdote : une enfant de deux ans bousculée par un petit camarade de jeux et au sujet duquel la maman se félicitait de ses capacités à se battre. La jeune victime, en revanche, avait le tort de ne pas être suffisamment pugnace ou, dit autrement, d’être "trop gentille". Nous avons tous été témoins de ces scènes familières autour de bacs à sable, de toboggans et autres balançoires : les tout petits auraient très vite des comportements sociaux qui les distinguent les uns des autres. Ces comportements, plusieurs participants – enseignants dans le cycle élémentaire – sont d’accord pour dire qu’ils sont façonnés par le culturel. L’enfant est amoral dès son jeune âge. C’est par l’expérience et en côtoyant ses semblables qu’il se construit. En somme, pour reprendre une célèbre expression de Simone de Beauvoir, on ne naît pas gentil : on le devient ! Encore que beaucoup d’entre nous ont constaté que deux éducations identiques – le mot "identique" est cependant fortement à nuancer – voient plusieurs frères et sœurs adopter des comportements différents : l’un(e) pourra être gentil(le), l’autre pas. Nature et culture restent, encore une fois, des sujets de débat, voire de controverse.
La gentillesse semblerait s’acquérir par l’expérience. L’un des aspects de ce comportement se manifeste par la non-violence, cette faculté à réagir à une agression par le pacifisme. Bruno rappelle qu’il y a un moins de trois ans, le café philosophique de Montargis traitait de cette non-violence. À l’époque, l’intervenant, Vincent Roussel, de la Coordination française pour la Décennie, avait insisté sur l’éducation des enfants à la non-violence afin de dégoupiller les conflits en classe et sur les cours de récréation. Cette recommandation n’est, hélas, toujours qu’un vœu pieu !
L’assistance du café philosophique poursuit sa discussion sur la place du culturel dans notre appréhension de la gentillesse. Une participante, de nationalité anglaise, porte un éclairage intéressant sur le gentil tel qu’il est vu en France. Nous avons dit que le "gentilhomme" avait disparu de notre paysage sociétal et que le gentil, son lointain avatar français, avait mauvaise presse. Cette participante confirme qu’elle a constaté chez beaucoup de nos concitoyens cette propension à déconsidérer la gentillesse. La mauvaise humeur et l’esprit râleur sont des caractéristiques françaises que nombre d’étrangers stigmatisent chez nous. Au contraire, en Grande-Bretagne, être gentil n’est pas une tare, loin de là. Être "kind" (de "kindness" : gentillesse) est une qualité appréciée, sans être dévalorisée. Ce n’est pas un hasard si le mot "gentleman" soit encore utilisé là-bas, alors que le "gentilhomme" est mort depuis longtemps en France. Bruno avance une explication à cette désaffection : après la Révolution française, en même temps que la société d’Ancien Régime disparaît (dont le gentilhomme), le besoin légitime d’égalité dans la société devient soif d’égalitarisme et méfiance vis-à-vis de notre voisin. Suis-je vraiment à égalité avec lui ? Si je montre altruiste, n’y a-t-il pas le risque que je sois "volé" par celui que je viendrais aider ? Emmanuel Jaffelin affirme ceci : "En France c'est plus difficile qu'ailleurs, la faute à la Révolution française qui a inscrit dans notre ADN un égalitarisme forcené, on pense qu'on s'abaisse en donnant, alors qu'en donnant, on se grandit" (cf. cet article). Loin d’être portée au pinacle, la gentillesse peut facilement être considérée avec méfiance ("Une certaine qualité de gentillesse est toujours signe de trahison" disait François Mauriac).
Il appartient sans doute à chacun de nous, dit un nouvel intervenant, de travailler à cette gentillesse. Comme il le rappelle à travers une fable indienne : deux loups luttent en nous, un bon et un mauvais ; le gagnant sera celui que nous nourriront.
Résultat d’un apprentissage, la gentillesse ou son absence peuvent également être dans certains cas le fruit d’un caractère inné, comme le rappelle une participante. C’est l’exemple – certes, extrême – des psychopathes, des cas pathologiques incapables de ressentir autre chose que l’envie, la colère, la haine mais jamais des sentiments empathiques, sauf à vouloir dissimuler ou mentir.
Un participant apporte un nouvel éclairage sur la gentillesse, un éclairage religieux et culturel ! Évoquer le pacifisme du gentil vient en résonance de l’invite de Jésus dans les Évangiles à "tendre la joue droite lorsque quelqu’un frappe la joue gauche" ("Vous avez appris qu'il a été dit: Œil pour œil et dent pour dent. Et moi, je vous dis de ne pas tenir tête au méchant; mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et à celui qui veut t'appeler en justice pour avoir ta tunique, abandonne encore ton manteau…" Évangile de Mathieu, V, 38-40). À l’instar de Gandhi, en se faisant l’apôtre (sic) de la non-violence, Jésus encourage chaque homme à accepter docilement une situation de conflit. N’est-ce pas aussi la caractéristique chez le gentil ? Un autre passage biblique évoque la figure légendaire d’un homme désintéressé se sacrifiant pour aider autrui (ou son prochain) : le "bon Samaritain". Cette fable nous conte l’histoire d’un homme blessé par des brigands qu’un étranger passant par là vient secourir sans état d’âme : le texte de cette fable ce trouve sur ce lien.
Cette parabole a été commentée par Françoise Dolto. La célèbre psychanalyste, prouve, s’il en est, que la gentillesse n’a pas été totalement oubliée du milieu philosophique. Dans son ouvrage L’Évangile au risque de la Psychanalyse, elle dit ceci au sujet de ce Bon Samaritain : "Notre prochain, c'est tous ceux qui, à l'occasion du destin, se sont trouvés là quand nous avions besoin d'aide, et nous l'ont donnée, sans que nous l'ayons demandée, et qui nous ont secourus sans même en garder le souvenir. Ils nous ont donné de leur plus-value de vitalité. Ils nous ont pris en charge un temps,' en un lieu où leur destin croisait notre chemin." Ce Bon Samaritain a eu un comportement exemplaire et édifiant. Est-ce pour autant jouable dans la vie de tous les jours ? Jacques Prévert ne disait-il pas, non sans cynisme, en parlant du geste de charité de l’évêque saint Martin de Tours partageant son manteau avec un pauvre frigorifié que "saint Martin a donné la moitié de son manteau à un pauvre : comme ça, ils ont eu froid tous les deux" ?
Mais c’est surtout de l’autre côté de l’Atlantique que nous vient l’apport le plus décisif au sujet de la gentillesse. Des philosophes contemporains ont étudié ce thème via l’éthique du Care (du verbe "to care" qui signifie : "soigner", "s’occuper de"). Ce mouvement philosophique née aux États-Unis (avec des spécialistes des sciences humaines telles Carol Gillian, Francesca Cancian ou Joan Tronto) durant les années 80 s’est développé en Europe ces dernières années, et plus particulièrement en France depuis une dizaine d’années (Paulette Guinchard, Sandra Laugier ou Patricia Paperman). L’éthique du Care a pour ambition de s’intéresser à l’altruisme et d’allier la raison à l’émotion. Les spécialistes du Care expliquent que nous sommes fondamentalement des êtres relationnels en perpétuelle interdépendance. En fin de compte, résume Bruno, l’ambition de l’éthique du Care est, dans une société contemporaine moulée dans l’individualisme, de "réparer le monde". Cf. interview de Carol Gillian sur notre site et cet article d’éclairage sur l’Éthique du Care.
Ce mouvement philosophique, qui n’en est qu’à ses débuts – et qui reste malgré tout encore très critiqué – place la gentillesse non plus comme un mouvement sentimental désuet propre à rire, ni comme une faiblesse dont il faudrait se méfier, mais comme une authentique vertu : une "petite vertu" comme le dit une certaine littérature un peu maladroitement, tant cette expression a une autre connotation… Bref, la gentillesse appartient à ces actes moraux désintéressés dont beaucoup peuvent regretter le délitement mais qui ne demande qu’à se développer.
Cette séance du café philosophique se termine par la mise au vote de trois propositions de sujets pour le prochain débat : "Justice : surveiller, punir ou guérir ?", "Et si on parlait d’amour ?" et "Puis-je savoir qui je suis ?" C’est ce dernier sujet qui est choisi. Rendez-vous le vendredi 1er mars 2013 pour une nouvelle séance du café philo, même lieu, même heure. Claire rappelle enfin que la séance qui suivra (programmée le 29 mars 2013, à confirmer) sera, comme en 2012 à la même époque, co-animée par des élèves de Terminale littéraire du Lycée Saint François de Sales de Gien.