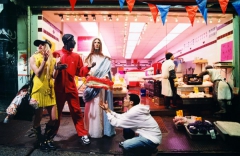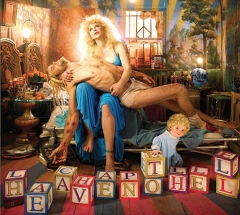Thème du débat : "Faut-il tout faire pour être heureux ?"
Date : 12 décembre 2014 à la Brasserie du centre commercial de la Chaussée
Le café philosophique de Montargis se réunissait le 12 décembre 2014 pour un débat portant sur cette question : "Doit-on tout faire pour être heureux ?" Une centaine de personnes était présente pour cette 45e séance.
Claire commence par préciser qu'il s'agissait d'un sujet proposé, en juin 2014, pour l'épreuve de philosophie du baccalauréat (section Littéraire).
Un premier participant problématise cette question : est-il question d'une obligation ? Qu'est-ce qu'être heureux (biens matériels, comportements, etc.) ? Quel est le rapport entre la notion de bonheur et celle de plaisir ("la récompense") ? Le "tout faire" pourrait impliquer que ce chemin vers le bonheur se ferait "au détriment des autres". La répartition des biens et des richesses en est une illustration, ajoute ce participant. La cupidité et la rapacité se font au détriment d'une immense majorité de personnes pauvres ou modestes (il est cité l'exemple des notaires – "pas forcément dans le besoin" – manifestant cette semaine pour conserver leur niveau de vie...). À l'inverse, certaines personnes altruistes sont heureuses lorsqu'elles apportent un peu de bien aux autres. Bruno rebondit en citant l'exemple de Fritz Zorn, Mars : le narrateur, issu d'un milieu bourgeois et aisé, trouve son salut – et une forme de bonheur – grâce à la maladie qui l'accable.
Pour un autre intervenant : "Il faut tout faire pour être heureux, parce que la vie est courte (... ), mais dans la limite du raisonnable". La question soulevée par une participante est celle de quantifier le bonheur : quand est-on heureux ? La réponse peut être dans une forme de comparaison. Une intervenante se demande si le bonheur ne résiderait pas dans l'absence de malheur, une optique dans laquelle s'engouffre le domaine pharmaceutique et les mises à disposition de psychotropes. Lorsque tout va bien, dit Claire, nous pouvons être dans un état d'allégresse, de joie, de spontanéité qui n'est sans doute pas à proprement parlé du bonheur. Par contre, c'est sans doute dans le malheur et dans les témoignages d'amour et de soutien que l'on pourrait retrouver la trace de ce bonheur.
Pour une participante, le bonheur est une exigence autant qu'un état personnel, lié à l'éducation, avec certainement une part génétique voire neurologique. Aux notions de bien et de mal, peut s'ajouter les notions de "bien vivre" et de "mal vivre". Tout faire pour être heureux semblerait ne pas vraiment avoir de sens, dit encore cette participante, car le bonheur semblerait être un état naturel ("On ne peut pas se forcer à être heureux : on l'est ou on l'est pas"). Par contre, ajoute-t-elle, certaines personnes, peuvent rendre malheureux les autres.
Pour une autre intervenante, le bonheur est souvent associé à quelque chose d'extérieur à soi que que l'on posséderait : la santé, l'amour, une famille, les biens matériels, etc. "Une récompense", est-il encore dit au cours de la soirée. L'autre remarque de cette intervenante réside autour de cette question : "Est-ce qu'il est obligatoire de faire quelque chose pour être heureux ?" Ne pourrait-on pas être heureux dans la quiétude épicurienne évoquée par Claire : accepter et ne rien faire. En un mot : le lâcher prise ?
Tout faire pour être heureux pose la question de l'âge : la jeunesse, remarque une personne de l'assistance, recherche le bonheur dans l'action, alors qu'avec l'âge cet état résiderait plutôt dans l'évitement de la douleur : l'ataraxie.
Claire revient sur cette notion de bonheur et d'obligation, évoquées plus haut : "Il y a la notion d'obligation mais aussi la notion de devoir". Le "tout faire" et le "doit-on" peuvent se regrouper autour de la notion de devoir. Autrement dit, je pourrais pratiquer un hédonisme tel que, par définition, je me devrais, pour être un homme, d'être heureux envers et contre tous. Du coup, peut-on et comment arriver à l'état de plénitude – qui est l'état du bonheur ? Car il s'agit bien de cela, ajoute Claire : le bonheur est cet état de plénitude, sans manque ni désir. On est heureux lorsque l'on satisfait ses désirs. Le bonheur résiderait dans l'avoir et la possession, l'assouvissement de ses désirs et donc, quelque part, dans l'accomplissement de soi.
La notion de devoir est importante, ajoute Claire, dans le sens où cela sous-entend une une forme d'exigence. Car, a contrario, si la finalité de la vie humaine n'est pas le bonheur, quelle est-elle ? La vérité ? La santé ? Autre chose ? Si l'on abandonne l'exigence du bonheur, peut-on mener une existence pertinente ? Pour une participante, la réponse est positive : on peut se contenter d'un "semi-bonheur" car, suite à ce semi-bonheur, "le reste arrivera" sans doute...
Est-ce que le bonheur ne résiderait pas plutôt dans l'ataraxie, l'absence de troubles de l'âme ? À ce sujet, Épicure dit que le plaisir est le commencement et la fin de toute vie heureuse. Mais dans sa Lettre à Ménécée, il précise que tous les plaisirs ne sont pas à rechercher ni toutes les douleurs à éviter. Par là, l'épicurisme n'est pas cette doctrine philosophique souvent caricaturée d'une invitation à "brûler la vie par les deux bouts" : Épicure recherche plutôt l'ataraxie, la quiétude, la sérénité. On peut penser qu'un bonheur ne peut s'atteindre si l'on est en conflit avec autrui. Mais donc ce cas, peut-on être heureux tout seul ? Et peut-on être heureux si l'on est malgré tout dans "l'attentat" envers son proche et son prochain ?
Claire réagit en précisant qu'étymologiquement, le "bon heur" est la "chance". Par exemple, les eudémonistes, qui sont ces philosophes qui cherchent à comprendre le bonheur et les moyens d'y accéder, ne parlent pas de "bon heur", tant cette notion de chance et de fortune (fortuna) nous échappe. Mais par contre, ils parlent du Souverain Bien (Aristote ou Épicure). Nous ne sommes plus alors dans l'action mais plutôt dans le délaissement. On va à l'essentiel et à ce qui nous caractérise singulièrement, ce qui fait que nous sommes nous-même et pas un autre, y compris dans le corps politique (polis). Le bonheur se situe dans le respect de soi-même et de l'autre. Nous sommes alors dans la dimension éthique du Souverain Bien.
Une participante remarque que ce débat sur le bonheur semble être très occidental, même si cette notion reste universelle. La France, pays développé et riche, fait partie de ces contrées dont les habitants sont les plus insatisfaits et les plus "malheureux" au monde. C'est aussi là, précise un autre intervenant, que se consomme le plus de psychotropes (du "bonheur de substitution"). Cette notion de bonheur est très relative et peut être mise en relief avec d'autres cultures, par exemple le Bouthan qui a remplacé le PNB (Produit National Brut) par le BNB (Bonheur National Brut). Un intervenant relativise cette posture : le BNB interdisait l'alcool, interdiction qui, par la suite a été levée, ce qui amis un sérieux coup de canif dans l'idéal de ce BNB !
Un autre intervenant parle de techniques modernes pour accéder au bonheur (la méditation de pleine conscience de Christophe André), de notions psychologiques ou psychiatriques (la résilience de Boris Cyrulnik) qui tendent à nous emmener vers une forme de bonheur immatériel : être en paix avec soi-même. Paul Watzlawick, de l'école de Palo Alto, dans l'ouvrage Faites-vous même votre Malheur, démontre comment certaines personnes s'enfoncent dans leur malheur, le ruminent et n'ont simplement jamais conscience de se sentir bien.
Un nouveau participant reprend la question d'origine : "Doit-on tout faire pour être heureux ?" Si l'on répond par la négative, on se place d'emblée dans le camp de ceux pour qui bonheur ou malheur laisse indifférent. Je me place en position de désintérêt par rapport à la vie et à ma propre existence, - voire, ajoute-t-il, dans un "état suicidaire". La recherche du bonheur (même s'il s'agit, comme dit plus haut d'un "demi bonheur"), est, selon lui, une nécessité absolue, tout en sachant qu'il sera difficilement accessible, notamment pour les personnes vivant dans le dénuement et le désœuvrement le plus total. Pour une autre personne du public, le bonheur peut s'organiser (il cite l'importance des vacances ou de sorties en groupes) : "Il faut se battre pour être heureux !" autant que donner. Mais tout en gardant en tête, ajoute une intervenante, l'impératif de la morale : "Pas de bonheur sans morale !" Et pas de bonheur sans autrui, est-il également dit au cours de ce débat.
Pour un autre intervenant, la condition fondamentale du bonheur est celle de la liberté. L'accès au bonheur semblerait bien être l'objectif que tout un chacun souhaite atteindre. Seulement, présenté par les eudémonistes comme le Souverain Bien, il s'agit d'un idéal et en tant qu'idéal il est inatteignable : "Le concept du bonheur est un concept si indéterminé, que, malgré le désir qu’a tout homme d’arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce que véritablement il désire et il veut", écrivait Emmanuel Kant. Jean Anouilh disait, de son côté : "Il ne faut pas croire exagérément au bonheur."
Pour Claire, il y a une nette distinction entre l'injonction "Je dois tout faire pour être heureux" par l'action d'une part et le travail sur soi afin d'acquérir une forme de sérénité d'autre part. Il est sans doute important de faire en sorte de donner un sens à sa vie (Sartre) ; a contrario, pour beaucoup de philosophes, si le bonheur se situe dans un état de projection, on perd tout car, par définition, s'évertuer à dire que l'on est heureux c'est oublier qu'on l'est déjà ! La philosophie stoïcienne dit par exemple qu'il y a ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas ; tout ce qui ne dépend pas de moi, je dois m'en détacher et tout ce qui dépend de moi, je dois l'apprécier. Pour Blaise Pascal, l'homme sera d'autant plus heureux lorsqu'il arrêtera de chercher à se divertir, le divertissement n'étant rien d'autre que la projection vers un bonheur illusoire, au risque d'oublier l'instant présent : la méditation et la contemplation, là, maintenant, serait préférable à la nostalgie comme à une recherche vaine vers un bonheur futur et hypothétique. Un participant cite à ce sujet Bouddha : "La joie se cueille, le plaisir se ramasse et le bonheur se cultive." Ce sont les petits bonheurs et les petits malheurs qui permettent d'accueillir la vie : "Goûtez tous les plaisirs et souffrez tous les maux / Et dites : c'est beaucoup et c'est l'ombre d'un rêve" (Jean Moréas), cite un participant.
Pour aller plus loin, la morale devrait-elle toujours prévaloir dans cette "construction du bonheur". Pascal dit : "Tous les hommes recherchent d’être heureux. Cela est sans exception, quelques différents moyens qu’ils y emploient. Ils tendent tous à ce but" (Pensée 138). Mais à le rechercher sans relâche, on oublie de vivre de manière pertinente, on s'oublie soi-même, si bien que "le présent ne nous satisfaisant jamais, l’espérance nous séduit, et, de malheur en malheur, nous mène jusqu’à la mort, qui en est le comble éternel". Une telle posture pose une question morale : s'accomplir soi-même vient en contradiction avec nos impératifs sociaux. Nous ne sommes sans doute jamais à notre place dans notre vie, la recherche du bonheur venant se heurter à une vie qui nous oblige. Le "connais-toi toi-même" socratique nous interpelle : est-ce que je suis à ma place ? Tout cela est une histoire d'appropriation.
Le bonheur, dit une autre intervenante, pourrait n'être qu'un fantasme. Un fantasme que de grandes idéologies du XXe siècle ont utilisé à des fins politiques, à décréter. Le bonheur ne serait pas à prendre d'un bloc mais comme une accumulation de petits événements ou de micro comportements à goûter ("Le bonheur est dans le pré ; cours-y vite cours-y vite ; le bonheur est dans le pré ; Cours y vite il va filer" dit une comptine célèbre). Bruno rebondit sur cette question de "bonheur collectif". Un bonheur collectif qui, depuis la fin du XXe siècle, n'existe plus et a été remplacé par le concept de bonheur individuel (thérapies de groupe, cours de sophrologie, etc.).
Parler du bonheur implique la nécessité et la capacité à le reconnaître lorsqu'il se présente à nous, réagit une nouvelle participante. Or, parfois, cette capacité nous ne l'avons pas. Le bonheur est aussi le fait d'appréhender le monde d'une certaine façon afin de "le rendre heureux". Lors d'une introspection, lors de mauvaises expériences, nous pouvons en tirer des conclusions et des leçons bénéfiques ("positiver les choses").
Ce qui est également en jeu à travers la question du bonheur est celle de la mort et de notre rapport à elle. Une intervenante cite l'Inde. Dans ce pays, la mort n'est pas taboue. Elle est présente de manière moins tragique que dans nos sociétés occidentales. Claire met en avant notre rapport moderne à la mort. Aucune mort n'est naturelle et tout décès est hasardeux, "alors que, dit Claire, la mort n'est pas un hasard ; c'est la vie qui en est un". Dans nos sociétés modernes, la mort, la vieillesse et le passé sont mises de côté. Seuls comptent le présent et le futur. On est dans la création. Le bonheur semblerait avoir un lien avec l'idée de sens : quelle orientation dois-je choisir de donner à ma vie.? Or, n'est-il par perdu d'avance de chercher à se construire dans un avenir hypothétique ? "L'homme avide est borné" disait Jean-Jacques Rousseau.
Dans le doit-on tout faire pour être heureux, peut-on choisir son malheur, quitte à faire souffrir aujourd'hui ? Ou bien mon bonheur ne devra-t-il passer que par l'acceptation d'autrui ? Ce qui se pose ici est celle d'une morale qui viendrait borner notre recherche du bonheur.
"Il y a une intelligence du bonheur", juge également un membre du public : certaines personnes ont plus d'aptitudes au bonheur que d'autres. Partant de cela, réagit un autre participant, "ceux qui n'en ont pas doivent aller chercher des astuces" pour être meilleur et heureux. Mais une telle considération sur "l'intelligence du bonheur" n'est-elle pas contredite par l'expression populaire "Espèce d'imbécile heureux !" ? Être trop intelligent ne serait-ce pas un frein à ce bonheur tant désiré. Ne faut-il pas revendiquer une certaine bêtise, à la manière de Candide ou l'Optimiste (Voltaire) ? Or, si l'on parle d'intelligence dans le bonheur, il ne s'agit pas d'une intelligence scientifique ou intellectuelle. Des peuplades reculées, dénuées de tout confort matériel, vivant parfois dans l'intelligence, peuvent être dans une parfaite harmonie et avec un détachement heureux. "Une puissance de vie", précise une participante.
Cela voudrait-il dire que le progrès et l'intelligence seraient un frein au bonheur ? Quelqu'un dans l'assistance répond par la négative : croire que la pauvreté permettraient de se raccrocher à l'essentiel est profondément illusoire. La construction d'une route, l'installation de l'électricité ou la mise en place d'écoles pour tous dans des régions reculées du monde peuvent participer d'un mouvement altruiste. La science, l'imagerie médicale, l'atterrissage d'un satellite artificiel sur une lointaine comète peuvent susciter une forme de bonheur, qui serait un bonheur collectif, une fierté pour le genre humain et le progrès qui a un certain sens.
Aujourd'hui, il y a bien une injonction à être heureux. Le "mal heureux" n'est pas bien considéré dans nos sociétés. Il gêne. Doit-on absolument être heureux ? Cette question, réagit un intervenant, peut ne pas se poser. Hannah Arendt, dans la Crise de la Culture (1961), revient sur la période de la résistance au cours de laquelle la question du bonheur individuel ne se posait pas, au contraire du bonheur collectif et de la recherche de la liberté. Spinoza parlait de la question du travail comme souffrance, mais ce travail, s'il est sublimé, peut devenir un plaisir. Or, le bonheur est cet effort (conatus) pour entrer dans cette obligation de vivre et de persévérer dans l'être ce qui nous procure la joie.
Mais comment construire un monde pour le bonheur des autres et de nos descendants ? La vitesse des sociétés occidentales peut nous mener vers une voie où le bonheur paraît factice dans une société compartimentée et modelée par la consommation. Un intervenant considère que le bonheur est une idée neuve... depuis 200 ans et se félicite qu'aujourd'hui chacun puisse prétendre au bonheur.
Bruno conclut ce débat par les paroles d'une chanson de Berry : "Le trésor n'est pas caché / Il est juste là / À nos pieds dévoilés / Il nous ferait presque tomber" (Le Bonheur). "Peut-être, ajoute-t-il, que le bonheur est là et peut-être ne le savons-nous pas". Alain disait également : "Le bonheur est une récompense qui vient à ceux qui ne l'ont pas cherché."
Trois sujets sont mis au vote pour la séance du 30 janvier 2015 : "L'enfer est-il pavé de bonnes intentions ?", "Autrui, antidote à la solitude ?" et "Le langage trahit-il la pensée ?" C'est ce dernier sujet qui est élu par la majorité des participants. Rendez-vous est pris à la Brasserie du centre commercial de la Chaussée pour le vendredi 30 janvier.