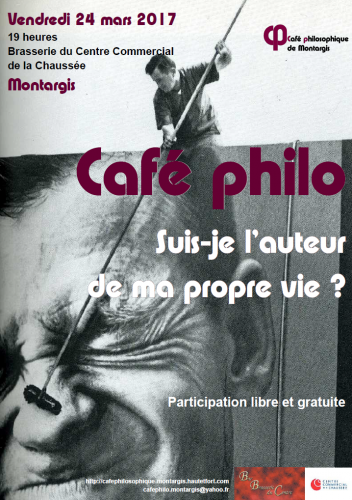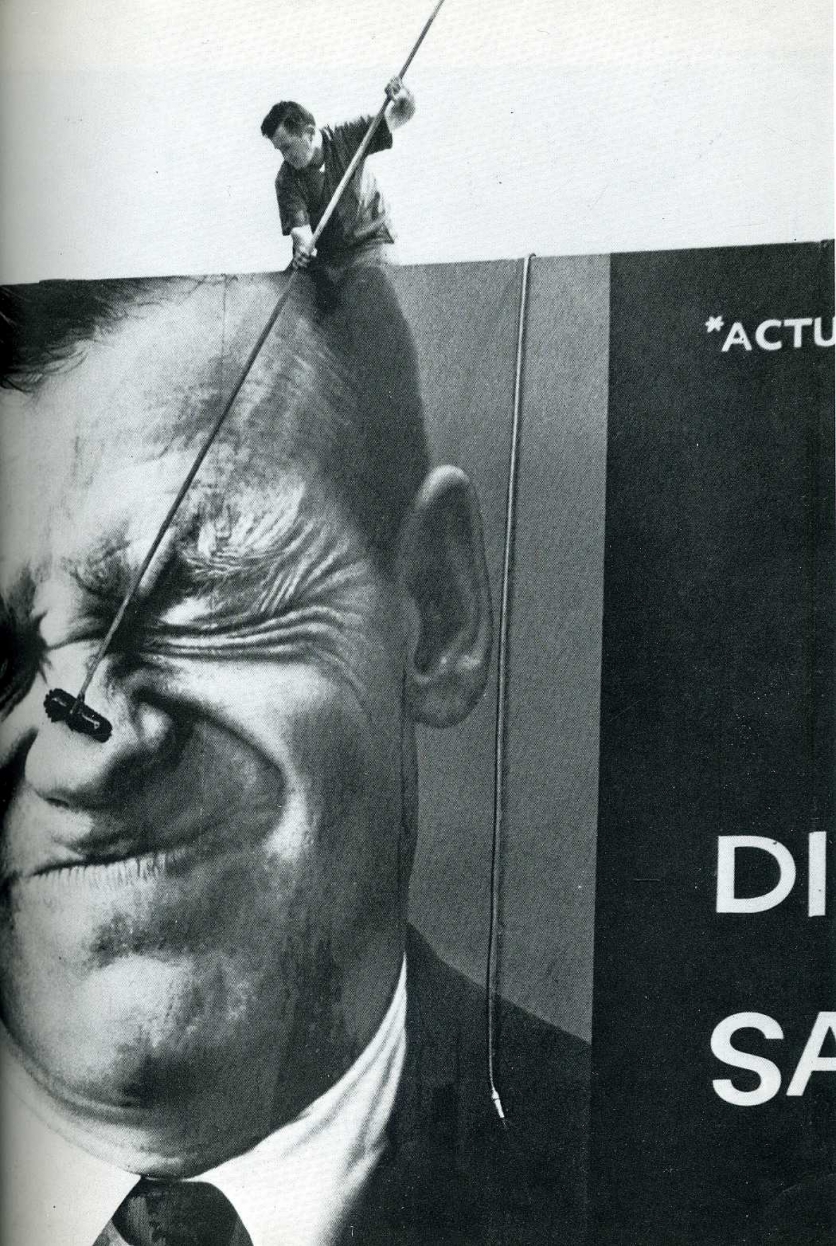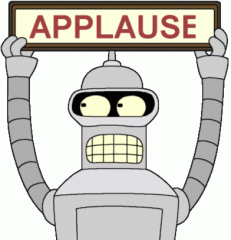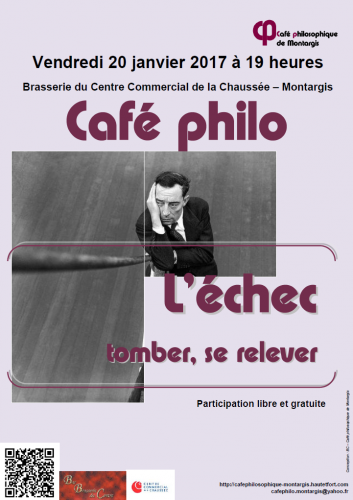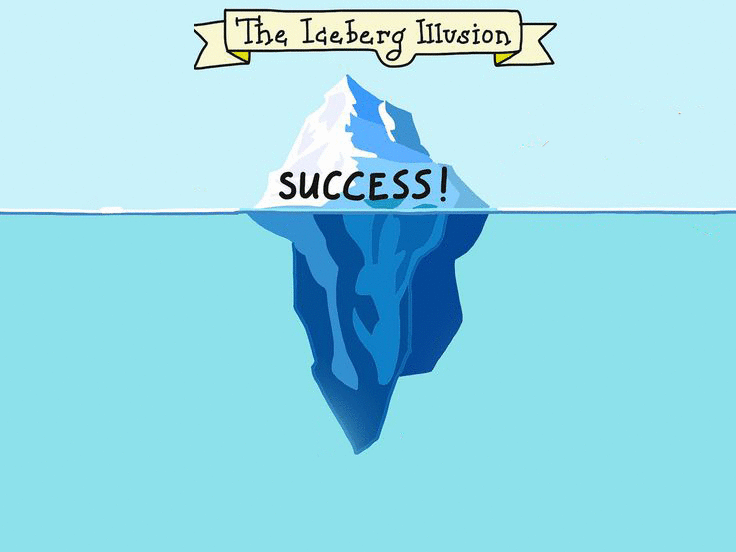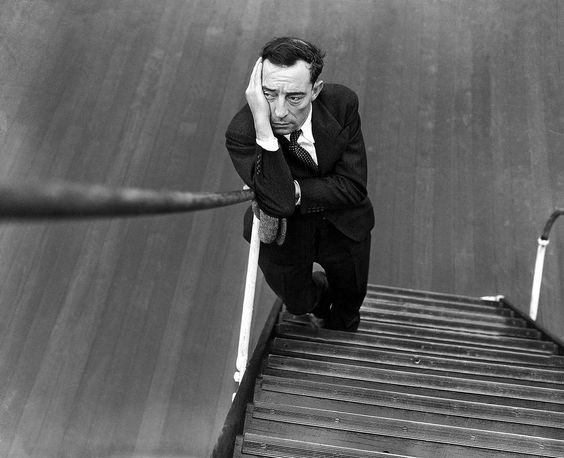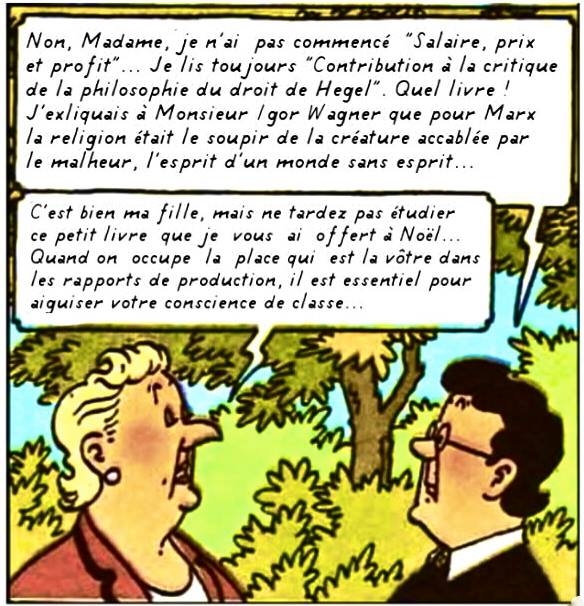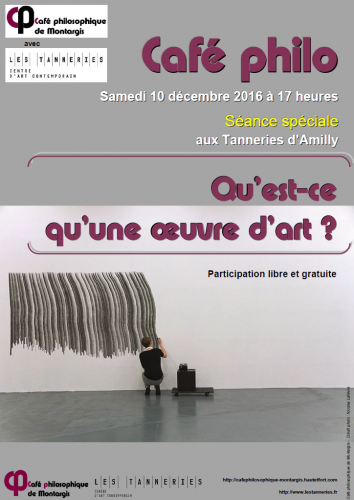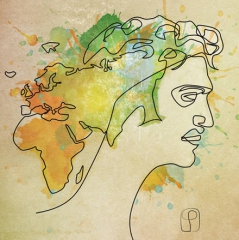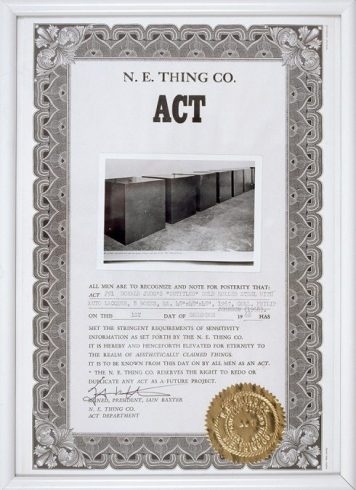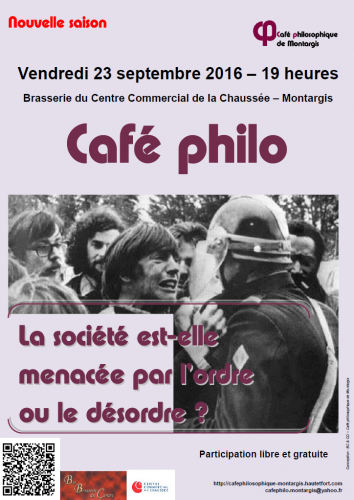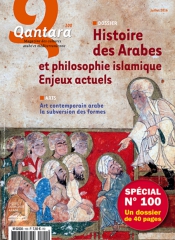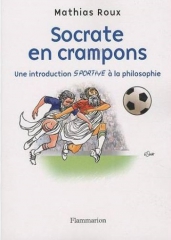Le café philosophique de Montargis proposait le 24 juin 2016 sa 58e séance, qui était également la dernière de la saison 7. Le débat de la soirée portait sur cette question : "Les mots sont-ils des armes ?", un débat est co-animé par Bruno, Claire et Virginie.
Une quarantaine de participants étaient présents. Avant de commencer la séance proprement dite, Bruno commence par remercier les personnes qui ont permis au café philosophique de Montargis de prendre un nouveau virage durant cette année. Bruno rappelle que depuis sa création en 2009, l’animation de la Chaussée fonctionnait en binôme grâce au duo qu’il formait avec Claire Durand. Avec le départ de Claire de la région fin 2015, le café philo devait trouver un nouveau fonctionnement grâce à une équipe élargie, ayant la tâche de pérenniser ce rendez-vous montargois. En cette fin de saison, Bruno constate que cet objectif a été atteint et il remercie les personnes qui ont accepté d’animer et d’organiser les séances du café philo durant cette saison. Bruno remercie en premier lieu Claire Bailly d’avoir accepté de s’investir avec gentillesse et compétence dans l’animation ainsi que Pascal Weber pour sa fidélité et son efficacité dans l’organisation technique et pratique. Un chaleureux remerciement est adressé aux autres personnes, animateurs pour la plupart, qui ont permis au café philo de fonctionner : Gilles Poirier, Claude Sabatier, Guylaine Goulfier, Virginie Daunias, Micheline Doizon mais aussi Catherine Armessen qui était présente pour le café philo sur la vengeance. Des remerciements sont également adressés pour leur aide à Jean-Claude Humilly, Gérard Vivian et le Marc Lalande, le responsable de la Brasserie de la Chaussée. Bruno adresse enfin un remerciement spécial à trois autres personnes : René Guichardan du café philo d’Annemasse et Guy-Louis Pannetier du café philo de l’Haÿ-les-Roses, sans oublier Claire Durand.
Pour amorcer le débat "Les mots sont-ils des armes ?", Bruno pose cette autre question aux participants : "Quels mots vous paraissent des armes ?" Une participante considère que parmi les mots à forte puissance il y a le mot "vérité" et le mot "calomnie". Un intervenant intervient au sujet du débat de ce soir sous forme de boutade : si les mots sont des armes, il importe de les désarmer et qu’on "fasse un café philo dans le silence !" Plus sérieusement, ajoute-t-il, les mots ne seraient des armes dans une forme de dialectique uniquement pour la personne qui les reçoit, se sentant "agressée" et "traumatisée". Une participante rebondit sur ces propos : les mots peuvent être autant des "armes de destruction massive" qu’une aide à la reconstruction individuelle (en psychanalyse). Tout dépend de la manière dont les mots sont exprimés et qui en est l’émetteur et le récepteur.
Pour une autre personne du public, le titre de ce débat nous place "dans une hypothèse de combattants" : deux adversaires s’affronteraient, s’agresseraient, se défendraient, via des mots en guise d’armes. Détruire, dénigrer, agresser par les mots apparaîtrait comme possible.
"Je donne un mot : j’accuse", ajoute un intervenant. Les mots peuvent être destructeurs (via les pamphlets, par exemple) autant que des armes au service d’une cause, voire de la non-violence. Un participant cite Marshall Rosenberg, théoricien de la communication non-violente, psychologue descendant de Carl Rogers, qui a écrit un que "les mots sont comme des fenêtres – ou bien ils sont des murs" ! Lorsque Émile Zola lance ces mots et cette lettre, J’accuse, il s’agit d’une arme au service d’une cause.
Les mots sont des moyens de communication des hommes entre eux, pour le meilleur et pour le pire comme le montre l’exemple de l’échange surréaliste entre Guillaume de Baskerville et Salvatore, le moine hérétique qui s’exprime dans une langue qu’il pense n’être connu que de lui seul, avant de s’avouer comme "vaincu" et "penaud" lorsqu’il se rend compte que ce n’est pas le cas et que sa langue le trahit.
Il y a des mots d’amour et des mots de haine : tout dépend de la fin des mots qui ne sont en soit ni bons ni mauvais. Le mot a plusieurs sens plausibles avec des sens positifs, négatifs ou neutres, dépendant de la gestuelle et du comportement, autant de non-dits qui structurent le mot. Par contre, en poésie, l’écrivain utilise le mot tel qu’il est, contrairement au discours politique par exemple.
Bruno réagit sur les premiers propos tenus autour de la question de ce soir. "Les mots sont-ils des armes ?" Les questions à se poser sont celles-ci : "De quelles armes parlons-nous ?" et "De quels mots parlons-nous ?" S’agit-il du mot en tant que mot isolé, le "slogan" ? S’agit-il d’un discours ? D’une citation ? S’agit-il d’un mot écrit ou d’un mot oral ?
Un nouvel intervenant considère que les mots sont des armes lorsqu’ils sont font partie d’un discours, d’une propagande despotique par exemple.
Pour un participant, les mots ne doivent pas être confondus avec le langage. Les mots permettent le langage mais aussi la pensée. Peut-on penser sans langage ? Une certaine richesse de vocabulaire irait de pair avec une certaine subtilité de la pensée, en sachant que le mot est souvent imprécis et qu’il est nécessaire mais pas suffisant pour exprimer. Le mot est moins porteur de sens que la chose qu’il est sensé désigner, comme dans l’art. Les mots peuvent être symboliques : le mot "mur" par exemple peut avoir des connotation différentes et ne sont pas si anodins que cela.
Virginie replace le débat dans la sphère philosophique et plus précisément dans la rhétorique, qui est l’art d’influencer grâce aux mots. Il est à double tranchant lorsqu’en politique la rhétorique est utilisée pour passer un message – que ce soit dans le bon sens ou le mauvais sens. La rhétorique use de ses qualités pour convaincre dans une fin électorale mais aussi commerciale. La rhétorique est l’art de bien parler, donc, et cet art peut donner un très grand pouvoir. La philosophie entend, par contre, rechercher la vérité sans les artifices des mots et sans la recherche du pouvoir grâce aux mots.
L’appauvrissement du langage est une réalité, considère une intervenante : mots limités, SMS, tweets, phrases courtes dénaturent et appauvrissent la réflexion. Pour un autre participant, le mot se doit d’être "domestiqué". Le mot n’est qu’un élément de la communication, parmi d’autres : le ton, le langage du corps, les mimiques, et cetera. Le langage verbale n’est qu’une partie de la communication et ce n’est du reste pas toujours la plus importante. Domestiquer la communication c’est apprendre dès le plus jeune âge que l’on est responsable de ce que l’on va transmettre, tout autant que je suis responsable de la manière dont je réceptionne ce qui est dit.
Une intervenante cite en exemple la pièce de Nathalie Sarraute, Pour un Oui ou pour un Non (voir lien). Elle narre l’histoire d’une relation amicale qui s’effrite à cause d’un mot, ou plus précisément de l’intonation d’un mot. Comme le disait Racine dans Britannicus : "J'entendrai des regards que vous croirez muets".
Une participante évoque "les phrases assassines", ces propos utilisés dans la vie quotidienne, jusque dans l’enfance et sources de traumatisme. Elle ajoute que "lorsque l’on parle, on induit la réponse de l’autre". Si j’agresse quelqu’un, j’ai de grandes chances d’être agressées par exemple. Tout dépend également du ton que l’on prend pour parler, tout dépend aussi si le mot est utilisé dans son sens premier ou bien s’il n’est pas dévoyé.
Le sophisme faisait partie de l’histoire de la philosophie en occident, ajoute Bruno, à telle enseigne que, pour partie, nous sommes en Occident les héritiers de ce mouvement de pensée présocratique. La place du mot, du discours, du débat, de l’argument est important en France (comme le prouvent les cafés philos!). L’art de convaincre via le sophisme a été fortement critiqué, d’abord par Platon (dont nous sommes aussi les héritiers). Pourquoi les sophistes ont-ils eu mauvaise presse ? D’abord parce qu’ils n’étaient pas Athéniens. En outre, ces "étrangers" se faisaient payer pour enseigner. C’était mal vu. Ils enseignaient l’art de convaincre, ce qui était capital à Athènes et pour la bonne marche de la démocratie athénienne.
L’art de parler pour convaincre a son pendant : la manipulation, qui est beaucoup discutée durant le débat. Dans 1984, George Orwell nous parle d’une dystopie, une société imaginaire et futuriste monstrueuse dominée par Big Brother, un dictateur omniscient. Or, parmi les mesures utilisés pour la soumission de son peuple figurait le travail sur la langue. Big Brother avait décidé de déstructurer la langue originelle et la transformer en une "novlangue", une langue appauvrie (cf. texte). L’appauvrissement de la langue fait partie des armes utilisés dans les discours des puissants (cf. enquête), un appauvrissement analysé notamment dans les discours présidentiels durant la Ve République.
Les mots seraient utilisés par les puissants pour dominer les faibles. En diplomatie, les terrains d’entente et de négociations usent de mots choisis avec tact et subtilité, "qui seraient presque des mots d’amour". Dans les religions, le mot Dieu désigne une abstraction bienfaitrice, synonyme de bonté et d’amour ; or, derrière ce mot, se cachent des combats violents et des pouvoirs cyniques qui utilisent ce mot pour contraindre à la soumission.
Une intervenant cite un mot utilisé abondamment récemment : "Brexit". Elle estime qu’il est synonyme de désunion, de manipulation politique mais aussi de crime, avec la mort de la députée travailliste Jo Cox. Dans l’assistance, une intervenante britannique réagit en citant l’un des grands maîtres de la rhétorique et de la répartie, Winston Churchill. Il savait ne pas être touché et blessé par des paroles d’un contradicteur, même violent. Elle cite une anecdote. Lady Ascot ne supportait pas Winston Churchill et lui dit un jour : "Sir, si vous étiez mon mari, j’aurais mis du poison dans votre café". Le premier ministre britannique lui avait répondu du tac au tac : "Madame Ascot, si vous étiez ma femme, je l’aurais bu." Face à des mots "armés", il a usé d’une défense imparable, grâce à d’autres mots.
La transmission des mots, dit une autre participante, induit la transmission d’une pensée : encore faut-il qu’émetteur et récepteur soient sur la même longueur d’onde, ce qui ne va pas de soi ! Même un individu bien intentionné et n’utilisant pas de mots à double tranchant peut froisser son interlocuteur sans le vouloir. A fortiori, les professionnels de la rhétorique savent parfaitement utiliser les formules, les mots, les syntaxes calculées pour asseoir leur maîtrise du public auquel ils s’adressent.
Le mot n’est certes pas en lui-même une arme, réagit Claire. Par contre, c’est l’interprétation que l’on en fait, ainsi que le contexte, qui peut transformer le mot en arme. Claire cite l’exemple du "Sibboleth ". Dans le livre des Juges, la tribu d’Éphraïm est opposée à la tribu de Galaad. Chaque tribu à une prononciation différente du mot "Sibboleth" – ou "Shibboleth". Une mauvaise prononciation est synonyme de non-appartenance à telle ou telle tribu et, au final de condamnation à mort. Le mot peut au final être trompeur lorsqu’on ne lui laisse pas une marge d’interprétation régionale ou sociale. Là, il peut être une réelle arme, comme le prouve l’exemple de Nathalie Sarraute.
Bruno s’interroge : aujourd’hui, est-ce que les discours ont toujours cette force et cette puissance qu’ils avaient ? Une participante réagit en parlant de George Orwell qui, en 1946, a écrit l’ouvrage Politics and the English Langage dans lequel il parle de la manière dont le langage est manipulé en politique afin de retirer aux mots leur sens. Noam Chomsky, ajoute Pascal, a fait cette histoire de la manipulation depuis l’Angleterre de la fin du XIXe siècle. Il montre comment le pouvoir a cherché à faire dévier les mots de leur sens pour instiller dans la population certaines idées. Après 1945, des think tanks ont été créés afin de transformer le langage, via des néologismes que décrit George Orwell lorsqu’il parle de la "novlangue" dans 1984.
À partir du moment où l’on pense en mots et non pas en images, si les mots pour penser ce que l’on veut penser n’existent plus, ou du moins sont altérés, alors la pensée est elle aussi altérée. Une pensée ne peut perdurer si elle n’est pas partagée via les mots, les discours. Le mot est une arme s’il est utilisé en masse et s’il a pour objectif de convaincre des personnes. La langue, aujourd’hui, semblerait être manipulée pour corseter notre pensée. Les discours manichéens font que nous sommes invités à échapper à la complexité d’un problème pour ne s’exprimer qu’à travers le "oui" ou le "non".
"Tu dis des mots. Encore des mots. Toujours les mêmes. Tu dis parfois. Tu dis souvent. N'importe quoi" chantait Alain Barrière. Les mots dans leur aspect le plus anodins restent importants en ce qu’ils sont le premier pas vers autrui. Jean-Paul Sartre parlait, de son côté, des mots dans son autobiographie justement intitulée Les Mots : son appréhension et son ouverture au monde est passée dès ses premières années par ce biais : "Puisque l’écrivain n’a aucun moyen de s’évader, nous voulons qu’il embrasse étroitement son époque ; elle est sa chance unique : elle s’est faite pour lui et il est fait pour elle... L’écrivain est en situation dans son époque : chaque parole a des retentissements." Les mots doivent devenir des armes défensives, dans un monde où le discours et le discours philosophique est de moins en moins audible. Il y a des armes défensives du penseur et du philosophe contre les armes offensives de la manipulation. Platon condamnait le sophisme dans le sens où le discours rhétorique était vide de sens, qu’il se suffisait à lui-même. Dans Gorgias, Platon met en scène un des plus célèbres sophistes de son époque pour mieux condamner ce courant intellectuel plaçant la rhétorique au coeur du fonctionnement de la Cité.
Lorsque nous parvenons à utiliser un discours plein de raison et d’intelligence, nous pouvons dédouaner des discours calamiteux pour prendre à contre-pied les personnes qui souhaitent nous flouer : "Sauvons les mots !" dit une participante. Le tout est de "dé-monter" ce que les autres veulent nous imposer pour remettre la vérité en ordre de bataille.
Lorsque l’on se trouve face à des discours publics, nous serions tentés de les prendre pour argent comptant, a fortiori lorsqu’ils viennent de personnes dites "spécialistes". Seulement, il y a notre libre-arbitre et notre étonnement philosophique peut nous amener à débusquer ce qui pourra nous éclairer. Les mots des philosophes sont-ils des armes ? Clairement, aujourd’hui les philosophes semblent être, sinon moins engagés qu’il y a quelques années, du moins plus discrets, voire inaudibles. Or, le citoyen doit chercher "des mots", des "connaissances". Les mots sont "des armes de la pensée", dit un participant et enrichir son vocabulaire c’est affiner et affûter sa pensée.
Bruno conclue par cette citation de Voltaire : "Je connais beaucoup de livres qui ont ennuyé, je n’en connais point qui aient fait de mal réel".
Les animateurs du café philo remercient le public et fixent leur prochain rendez-vous pour le prochain café philosophique de Montargis l’avant-dernier vendredi de septembre (date à confirmer) pour débuter sa 8e saison.