Café philo janvier 2025
Café philosophique de Montargis - Page 36
-
-
Betty Milan : Pourquoi Lacan
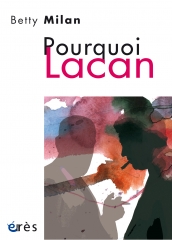 Au sujet de Jacques Lacan, dont Betty Milan est à la fois une admiratrice et une disciple, le lecteur de son court essai Pourquoi Lacan (éd. Érès) pourra avoir l’image d’un psychanalyste élitiste, obscur et qui cultivait cette approche déroutante : "Un maître dont la pratique exigeait la plus grande patience" et avait du mal à "se soumettre aux impératifs de la communication immédiate".
Au sujet de Jacques Lacan, dont Betty Milan est à la fois une admiratrice et une disciple, le lecteur de son court essai Pourquoi Lacan (éd. Érès) pourra avoir l’image d’un psychanalyste élitiste, obscur et qui cultivait cette approche déroutante : "Un maître dont la pratique exigeait la plus grande patience" et avait du mal à "se soumettre aux impératifs de la communication immédiate".Ceci dit, ce Pourquoi Lacan a cette immense qualité d’être immédiatement accessible. Il se lit comme le témoignage d’une femme dont la rencontre avec Jacques Lacan s’est d’abord faite sur le divan du plus grand psychanalyste, avec Sigmund Freud. "Il a changé ma vie. Il m’a permis d’accepter mes origines, mon sexe biologique et la maternité", écrit Betty Milan en début d’ouvrage.
"J’ai fait mon analyse avec Lacan dans les années 1970. Quarante ans après sa mort, j’ai eu envie de revenir sur ce qui s’était passé au 5 rue de Lille" annonce l’auteure dès l'ouverture. À l’époque, celle qui n’est encore qu’étudiante brésilienne en psychiatrie se paie l’audace de frapper au cabinet du célèbre praticien et scientifique, au départ pour préparer un séminaire au Brésil sur les théories lacaniennes. Betty Milan est à Paris pour raisons universitaires mais cet exil s’expliquait aussi par les liens intellectuels de la France et de son pays d’origine. La situation politique du Brésil, en pleine dictature à l’époque, n’est pas non plus étrangère à sa présence au pays de Voltaire. La première visite chez Lacan sera suivie par plusieurs autres, dans le cadre d’une analyse.
Grâce au témoignage de Betty Milan, le spectateur entre dans la tête d’une jeune Brésilienne des années 70, tiraillée entre plusieurs cultures puisque sa famille est originaire du Liban. Sa reconnaissance pour le psychanalyste ("Le Docteur" comme elle l’appelle) est immense : "Lacan a éclairé ma route, en permettant qu’une descendante d’immigrants libanais, victime de la xénophobie des autres et de la sienne propre, puisse enfin s’accepter".
L’ancienne analysée, devenue elle-même psychanalyste – lacanienne –, fait entrer le lecteur dans le cabinet du praticien et relate les échanges qu’elle a pu avoir avec lui au cours de séances souvent courtes. Elle raconte comment Jacques Lacan interrompait ses séances au moment où des informations pourtant importantes, commençaient à être révélées.
Betty Milan parle des rendez-vous réguliers, de l’interprétation des rêves, de la place de l’argent mais aussi du problème de la langue maternelle qui constituait a priori un obstacle à l’analyse (en ce sens, le titre Pourquoi Lacan – sans point d’interrogation – prend tout son sens).
Betty Milan parle aussi de la France, de Paris, des années 70 mais aussi du déracinement et de ses questionnements sur ses origines et sa liberté de femme. Car c’est bien de la réinvention de la vie dont il est question dans cette analyse d’une analyse chez une figure historique des sciences humaines disparue en 1981.
Betty Milan, Pourquoi Lacan, éd. Érès, 2021, 160 p.
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4773/pourquoi-lacan
https://www.bettymilan.com.br/frVoir aussi : "En tongs avec Platon"
"Lorsque les arbres pensent" -
Bonnes vacances !

Le café philosophique de Montargis prend quelques jours de vacances.
A bientôt !
Photo : Med Gadon - Pexels
-
Malraux : L'art du passé et le présent
 Il est impossible de concevoir le Musée comme historique. Pour un peintre du moins. Ce serait simplement ridicule. Vous vous imaginez un peintre qui arrive devant le Musée en considérant chaque salle comme un produit? Les colonies produisent des bananes... Le XVIe siècle produit l'art du XVIe siècle? C'est dément! Il est bien entendu que pour n'importe quel peintre, ce qui compte de l'art du passé est présent... J'avais pris l'exemple du saint : pour celui qui prie, le saint a son point d'appui dans une vie historique. Mais il a une autre vie au moment où on est en train de le prier : quand on le prie, il est présent. En somme, le saint est dans trois temps : il est dans son éternité, il est dans son temps historique ou chronologique, et il est dans le présent. Pour moi, ce serai t presque la réponse à la question "qu'est-ce pour vous qu'une œuvre d'art?" C'est une œuvre qui a un présent. Alors que tout le reste du passé n'a pas de présent. Alexandre a une légende, il a une histoire, mais il n'a pas de présent. Vous sentez bien que vous ne pouvez pas ressentir de la même façon une peinture de Lascaux (i) et un silex taillé. Le silex taillé est dans l'histoire chronologique. Le bison peint y est aussi, mais en même temps, il est ailleurs. Et là, vous mettez le doigt sur ce qui est absolument fondamental à mes yeux. Ce que je dis d'important, c'est ça on ne peut pas concevoir l'art moderne, dans ses rapports avec le musée imaginaire, etc., si on ne commence pas par ressentir que l'œuvre d'art de notre temps est dans un temps qui n'est pas soumis à l'ordre chronologique.
Il est impossible de concevoir le Musée comme historique. Pour un peintre du moins. Ce serait simplement ridicule. Vous vous imaginez un peintre qui arrive devant le Musée en considérant chaque salle comme un produit? Les colonies produisent des bananes... Le XVIe siècle produit l'art du XVIe siècle? C'est dément! Il est bien entendu que pour n'importe quel peintre, ce qui compte de l'art du passé est présent... J'avais pris l'exemple du saint : pour celui qui prie, le saint a son point d'appui dans une vie historique. Mais il a une autre vie au moment où on est en train de le prier : quand on le prie, il est présent. En somme, le saint est dans trois temps : il est dans son éternité, il est dans son temps historique ou chronologique, et il est dans le présent. Pour moi, ce serai t presque la réponse à la question "qu'est-ce pour vous qu'une œuvre d'art?" C'est une œuvre qui a un présent. Alors que tout le reste du passé n'a pas de présent. Alexandre a une légende, il a une histoire, mais il n'a pas de présent. Vous sentez bien que vous ne pouvez pas ressentir de la même façon une peinture de Lascaux (i) et un silex taillé. Le silex taillé est dans l'histoire chronologique. Le bison peint y est aussi, mais en même temps, il est ailleurs. Et là, vous mettez le doigt sur ce qui est absolument fondamental à mes yeux. Ce que je dis d'important, c'est ça on ne peut pas concevoir l'art moderne, dans ses rapports avec le musée imaginaire, etc., si on ne commence pas par ressentir que l'œuvre d'art de notre temps est dans un temps qui n'est pas soumis à l'ordre chronologique.André Malraux, Lazare. Le Miroir des Limbes (1974)
-
"L'internationale" : "Du passé faisons table rase"
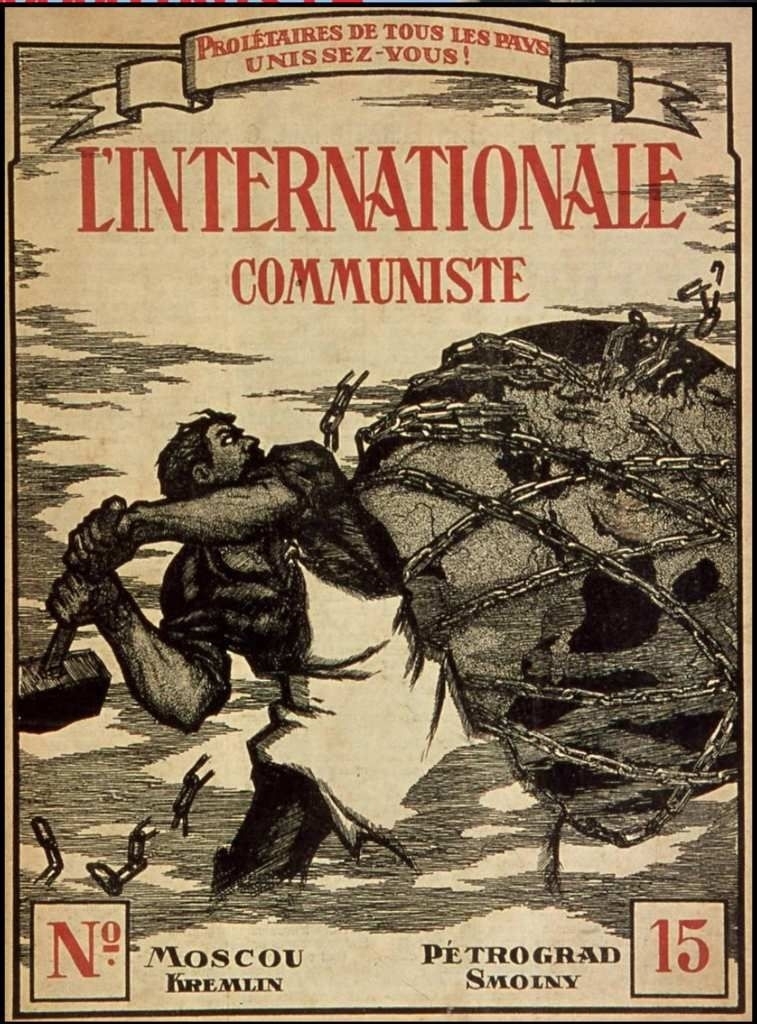
Debout, les damnés de la terre
Debout, les forçats de la faim
La raison tonne en son cratère,
C'est l'éruption de la faim.
Du passé faisons table rase.Eugène Pottier et Pierre Degeyter, L'Internationale (1871)
-
"Le Grand Meaulnes"
-
Alain-Fournier : Le Grand Meaulnes
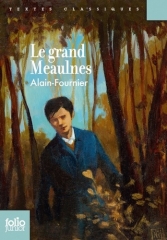 C’est ainsi, du moins, que j’imagine aujourd’hui notre arrivée. Car aussitôt que je veux retrouver le lointain souvenir de cette première soirée d’attente dans notre cour de Sainte-Agathe, déjà ce sont d’autres attentes que je me rappelle ; déjà, les deux mains appuyées aux barreaux du portail, je me vois épiant avec anxiété quelqu’un qui va descendre la grand’rue. Et si j’essaie d’imaginer la première nuit que je dus passer dans ma mansarde, au milieu des greniers du premier étage, déjà ce sont d’autres nuits que je me rappelle ; je ne suis plus seul dans cette chambre ; une grande ombre inquiète et amie passe le long des murs et se promène. Tout ce paysage paisible — l’école, le champ du père Martin, avec ses trois noyers, le jardin dès quatre heures envahi chaque jour par des femmes en visite — est à jamais, dans ma mémoire, agité, transformé par la présence de celui qui bouleversa toute notre adolescence et dont la fuite même ne nous a pas laissé de repos.
C’est ainsi, du moins, que j’imagine aujourd’hui notre arrivée. Car aussitôt que je veux retrouver le lointain souvenir de cette première soirée d’attente dans notre cour de Sainte-Agathe, déjà ce sont d’autres attentes que je me rappelle ; déjà, les deux mains appuyées aux barreaux du portail, je me vois épiant avec anxiété quelqu’un qui va descendre la grand’rue. Et si j’essaie d’imaginer la première nuit que je dus passer dans ma mansarde, au milieu des greniers du premier étage, déjà ce sont d’autres nuits que je me rappelle ; je ne suis plus seul dans cette chambre ; une grande ombre inquiète et amie passe le long des murs et se promène. Tout ce paysage paisible — l’école, le champ du père Martin, avec ses trois noyers, le jardin dès quatre heures envahi chaque jour par des femmes en visite — est à jamais, dans ma mémoire, agité, transformé par la présence de celui qui bouleversa toute notre adolescence et dont la fuite même ne nous a pas laissé de repos.Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes (1913)
-
"Non je n'ai rien oublié"
-
"Anatomie d'un scandcale"
-
Arsène K. : Une nouvelle chance
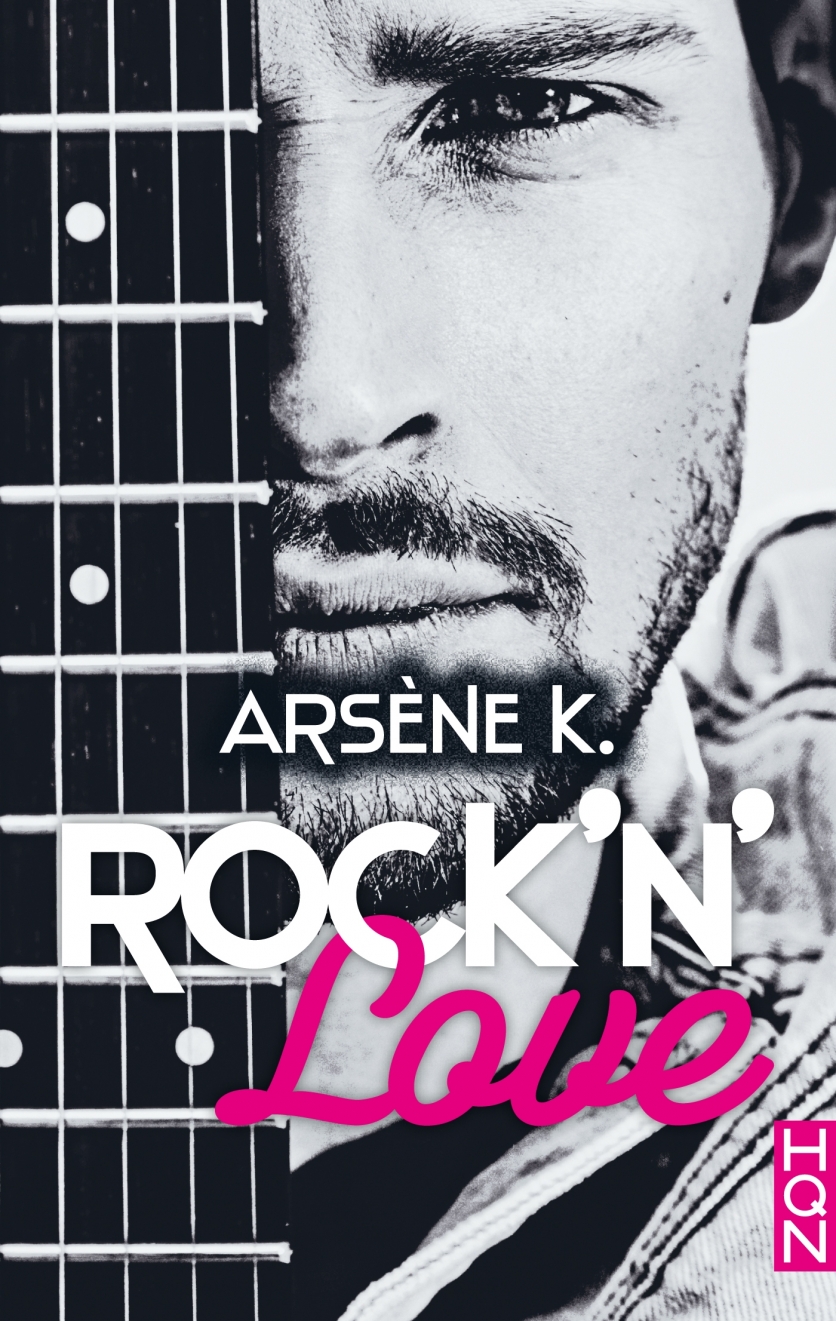
— Comment tu savais ? le coupai je.
— Comment je savais quoi ?
— Comment tu savais, pour ma réputation ? Comment tu savais où je travaillais ? Alessandro, ça fait vingt ans que l’on ne s’est pas vus, et voilà que tu débarques comme une fleur…
— Je dois être honnête avec toi, Lucrèce. Je ne t’ai jamais vraiment perdue de vue. J’ai toujours regretté que tu… que… qu’on se soit séparés comme ça… Après ton départ, je me suis senti comme… comme un avion sans ailes… Tu ne m’as laissé aucune chance… Aucun moyen de m’expliquer et de me racheter. Mais, bon, je suppose que c’est la vie et que je l’avais mérité… Pourquoi venait‑il me parler d’un passé révolu ? J’avais une furieuse envie de raccrocher, d’autant que William éteignait sa cigarette et s’apprêtait à quitter les lieux. J’allais le perdre de vue.
— Te laisser une chance ? Franchement, tu es gonflé de me dire ça…Arsène K., Rock and Love (2020)
http://www.bla-bla-blog.com -
"Time After Time"
-
Alain : Le "je" et l'âme immortelle

Le mot Je est le sujet, apparent ou caché, de toutes nos pensées. Quoi que je tente de dessiner ou de formuler sur le présent, le passé ou l’avenir, c’est toujours une pensée de moi que je forme ou que j’ai, et en même temps une affection que j’éprouve. Ce petit mot est invariable dans toutes mes pensées. « Je change », « je vieillis », « je renonce », « je me convertis » ; le sujet de ces propositions est toujours le même mot. Ainsi la proposition : « je ne suis plus moi, je suis autre », se détruit elle-même. De même la proposition fantaisiste : « je suis deux », car c’est l’invariable Je qui est tout cela. D’après cette logique si naturelle, la proposition "Je n’existe pas" est impossible. Et me voilà immortel, par le pouvoir des mots. Tel est le fond des arguments par lesquels on prouve que l’âme est immortelle ; tel est le texte des expériences prétendues, qui nous font retrouver le long de notre vie le même Je toujours identique.
Alain, Les Passions et la sagesse (1960)
Photo : KoolShooters
-
Arendt : Retour de bâton

L'une des découvertes du gouvernement totalitaire a été la méthode consistant à creuser de grands trous dans lesquels enterrer les faits et les événements malvenus, vaste entreprise qui n'a pu être réalisée qu'en assassinant des millions de gens qui avaient été les acteurs ou les témoins du passé. Le passé était condamné à être oublié comme s'il n'avait jamais existé. Assurément, personne n'a voulu suivre la logique sans merci de ces dirigeants passés, surtout depuis, comme nous le savons désormais, qu'ils n'ont pas réussi...
Si l'histoire - par opposition aux historiens, qui tirent les leçons les plus hétérogènes de leurs interprétations de l'histoire - a des leçons à nous enseigner, cette Pythie me semble plus cryptique et obscure que les prophéties notoirement peu fiables de l'oracle de Delphes. Je crois plutôt avec Faulkner que « le passé ne meurt jamais, il ne passe même pas », et ce, pour la simple et bonne raison que le monde dans lequel nous vivons à n'importe quel moment est le monde du passé ; il consiste dans les monuments et les reliques de ce qu'ont accompli les hommes pour le meilleur comme pour le pire ; ses faits sont toujours ce qui est devenu (comme le suggère l'origine latine du mot fieri - factum est). En d'autres termes, il est assez vrai que le passé nous hante ; c'est d'ailleurs la fonction du passé de nous hanter, nous qui sommes présents et souhaitons vivre dans le monde tel qu'il est réellement, c'est-à-dire qui est devenu ce qu'il est désormais."
Hannah Arendt, Retour de Bâton (1975)
-
"Yellowjackets"
-
Jankélévitch : Oubli et irréversibilité
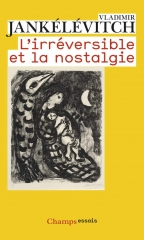 L'oubli, gommant le contenu empirique de la chose faite, laquelle est toujours oubliable, dénude l'effectivité du fait d'avoir-eu-lieu dans ses deux formes principales, l'avoir-été et surtout l'avoir-fait ; cette effectivité on peut la dire, par manière de parler, « inoubliable » ; toute chose faite ou vécue peut être tôt ou tard remémorée par l'un, oubliée par l'autre, mais l'effectivité de l'avoir-eu-lieu est, pour ainsi dire, en elle-même inoubliable, ou plutôt soustraite à priori à l'alternative précaire de la mémoire et de l'oubli ; mieux encore - l'oubli et la mémoire psychologiques n'ont pas de sens par rapport à elle ; et même si les habitants de la planète oubliaient tous ensemble que la chose a eu lieu, la chose éternellement et universellement oubliée n'en subsisterait pas moins, indépendamment de moi et de toi, dans une espèce de ciel métempirique, présente virtuellement pour un témoin quelconque, omniprésente et omniabsente et à tout moment remémorable ; il suffit qu'elle ait eu lieu, fût- ce un instant. Ce qui s'atténue et s'exténue et s'amenuise par l'effet du devenir irréversible, c'est le retentissement de l'événement et son écho de plus en plus lointain, non pas le fait qu'il est une fois advenu. D'abord dans l'ordre de l'avoir-été : le rescapé d'Auschwitz peut, au fil des ans, avoir perdu tout souvenir de son calvaire, n'y plus penser et n'en parler jamais, ne tenir nul compte, dans sa vie présente, d'un passé maudit définitivement enseveli ; la marque indélébile imprimée sur son bras par les bourreaux immondes s'est peu à peu effacée ; les ultimes conséquences ou, comme dit la médecine des camps, les dernières « séquelles » de sa misère ont disparu sans laisser la moindre trace ; tout est liquidé, compensé, oublié et, de surcroît, pardonné. La page est donc tournée... Hélas ! Ne tournez pas ! Attendez encore ! Un instant encore avant de tourner cette page... Quel est ce dernier scrupule sur le seuil du pardon ? Quelle est cette différence infinitésimale et parfaitement inconsciente, quelle est cette diaphora pneumatique et impalpable qui fait du survivant de l'enfer un homme pas tout à fait comme les autres ? Rien de dosable ni de pondérable sans doute... Seulement un certain air lointain, je ne sais quelle lueur étrange et fugitive dans le regard : cette indéfinissable lueur est comme le reflet métempirique de l'inexpiable, c'est-à-dire de l'impardonnable, c'est-à-dire de l'irrévocable. Et plus le survivant de l'enfer enveloppe de silence cette chose inavouable, plus lourdement l'indicible pèse sur son existence.
L'oubli, gommant le contenu empirique de la chose faite, laquelle est toujours oubliable, dénude l'effectivité du fait d'avoir-eu-lieu dans ses deux formes principales, l'avoir-été et surtout l'avoir-fait ; cette effectivité on peut la dire, par manière de parler, « inoubliable » ; toute chose faite ou vécue peut être tôt ou tard remémorée par l'un, oubliée par l'autre, mais l'effectivité de l'avoir-eu-lieu est, pour ainsi dire, en elle-même inoubliable, ou plutôt soustraite à priori à l'alternative précaire de la mémoire et de l'oubli ; mieux encore - l'oubli et la mémoire psychologiques n'ont pas de sens par rapport à elle ; et même si les habitants de la planète oubliaient tous ensemble que la chose a eu lieu, la chose éternellement et universellement oubliée n'en subsisterait pas moins, indépendamment de moi et de toi, dans une espèce de ciel métempirique, présente virtuellement pour un témoin quelconque, omniprésente et omniabsente et à tout moment remémorable ; il suffit qu'elle ait eu lieu, fût- ce un instant. Ce qui s'atténue et s'exténue et s'amenuise par l'effet du devenir irréversible, c'est le retentissement de l'événement et son écho de plus en plus lointain, non pas le fait qu'il est une fois advenu. D'abord dans l'ordre de l'avoir-été : le rescapé d'Auschwitz peut, au fil des ans, avoir perdu tout souvenir de son calvaire, n'y plus penser et n'en parler jamais, ne tenir nul compte, dans sa vie présente, d'un passé maudit définitivement enseveli ; la marque indélébile imprimée sur son bras par les bourreaux immondes s'est peu à peu effacée ; les ultimes conséquences ou, comme dit la médecine des camps, les dernières « séquelles » de sa misère ont disparu sans laisser la moindre trace ; tout est liquidé, compensé, oublié et, de surcroît, pardonné. La page est donc tournée... Hélas ! Ne tournez pas ! Attendez encore ! Un instant encore avant de tourner cette page... Quel est ce dernier scrupule sur le seuil du pardon ? Quelle est cette différence infinitésimale et parfaitement inconsciente, quelle est cette diaphora pneumatique et impalpable qui fait du survivant de l'enfer un homme pas tout à fait comme les autres ? Rien de dosable ni de pondérable sans doute... Seulement un certain air lointain, je ne sais quelle lueur étrange et fugitive dans le regard : cette indéfinissable lueur est comme le reflet métempirique de l'inexpiable, c'est-à-dire de l'impardonnable, c'est-à-dire de l'irrévocable. Et plus le survivant de l'enfer enveloppe de silence cette chose inavouable, plus lourdement l'indicible pèse sur son existence.Vladimir Jankélévitch, L'Irréversible et la Nostalgie (1974)
-
Kundera : La Plaisanterie
 Oui, j'y voyais clair soudain : la plupart des gens s'adonnent au mirage d'une double croyance : ils croient à la pérennité de la mémoire (des hommes, des choses, des actes, des nations) et à la possibilité de réparer (des actes, des erreurs, des péchés, des torts). L'une est aussi fausse que l'autre. La vérité se situe juste à l'opposé : tout sera oublié et rien ne sera réparé. Le rôle de la réparation (et par la vengeance et par le pardon) sera tenu par l'oubli. Personne ne réparera les torts commis, mais tous les torts seront oubliés.
Oui, j'y voyais clair soudain : la plupart des gens s'adonnent au mirage d'une double croyance : ils croient à la pérennité de la mémoire (des hommes, des choses, des actes, des nations) et à la possibilité de réparer (des actes, des erreurs, des péchés, des torts). L'une est aussi fausse que l'autre. La vérité se situe juste à l'opposé : tout sera oublié et rien ne sera réparé. Le rôle de la réparation (et par la vengeance et par le pardon) sera tenu par l'oubli. Personne ne réparera les torts commis, mais tous les torts seront oubliés.Milan Kundera, La Plaisanterie (1967)
-
"Tout oublier"
-
Nietzsche : oubli et "inertia"
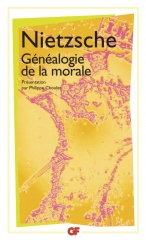 L'oubli n'est pas simplement une vis inertiae, comme le croient les esprits superficiels, mais plutôt une faculté de rétention active, positive au sens le plus rigoureux, à laquelle il faut attribuer le fait que tout ce que nous vivons, éprouvons, ce que nous absorbons, accède aussi peu à la conscience dans l'état de digestion (on pourrait l’appeler « absorption spirituelle ») que tout le processus infiniment complexe, selon lequel se déroule notre alimentation physique, ce qu'on appelle l’« assimilation ». Fermer de temps à autre les portes et les fenêtres de la conscience; rester indemne du bruit et du conflit auxquels se livre, dans leur jeu réciproque, le monde souterrain des organes à notre service; faire un peu silence, ménager une tabula rasa de la conscience, de façon à redonner de la place au nouveau, surtout aux fonctions et fonctionnaires les plus nobles, au gouvernement, à la prévoyance, à la prédiction (car notre organisme est organisé d'une manière oligarchique), voilà l'utilité de ce que j'ai appelé l'oubli actif, qui, pour ainsi dire, garde l'entrée, maintient l'ordre psychique, la paix, l'étiquette : ce qui permet incontinent d'apercevoir dans quelle mesure, sans oubli, il ne saurait y avoir de bonheur, de belle humeur, d'espérance, de fierté, de présent. L'homme chez qui cet appareil de rétention est endommagé et se bloque est comparable à un dyspeptique (et ce n'est pas qu'une comparaison) - il n'en a jamais « fini ».
L'oubli n'est pas simplement une vis inertiae, comme le croient les esprits superficiels, mais plutôt une faculté de rétention active, positive au sens le plus rigoureux, à laquelle il faut attribuer le fait que tout ce que nous vivons, éprouvons, ce que nous absorbons, accède aussi peu à la conscience dans l'état de digestion (on pourrait l’appeler « absorption spirituelle ») que tout le processus infiniment complexe, selon lequel se déroule notre alimentation physique, ce qu'on appelle l’« assimilation ». Fermer de temps à autre les portes et les fenêtres de la conscience; rester indemne du bruit et du conflit auxquels se livre, dans leur jeu réciproque, le monde souterrain des organes à notre service; faire un peu silence, ménager une tabula rasa de la conscience, de façon à redonner de la place au nouveau, surtout aux fonctions et fonctionnaires les plus nobles, au gouvernement, à la prévoyance, à la prédiction (car notre organisme est organisé d'une manière oligarchique), voilà l'utilité de ce que j'ai appelé l'oubli actif, qui, pour ainsi dire, garde l'entrée, maintient l'ordre psychique, la paix, l'étiquette : ce qui permet incontinent d'apercevoir dans quelle mesure, sans oubli, il ne saurait y avoir de bonheur, de belle humeur, d'espérance, de fierté, de présent. L'homme chez qui cet appareil de rétention est endommagé et se bloque est comparable à un dyspeptique (et ce n'est pas qu'une comparaison) - il n'en a jamais « fini ».Friedrich Nietzsche, Généalogie de la morale (1887)
-
Nietzsche : la faculté d'oublier
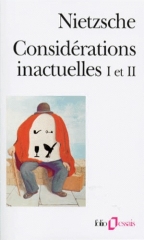 Qu'il s'agisse du plus petit ou du plus grand, il est toujours une chose par laquelle le bonheur devient le bonheur : la faculté d'oublier ou bien, en termes plus savants, la faculté de sentir les choses, aussi longtemps que dure le bonheur, en dehors de toute perspective historique. Celui qui ne sait pas s'installer au seuil de l'instant, en oubliant tout le passé, celui qui ne sait pas, telle une déesse de la victoire, se tenir debout sur un seul point, sans crainte et sans vertige, celui-là ne saura jamais ce qu'est le bonheur, pis encore : il ne fera jamais rien qui rende les autres heureux. Représentez-vous, pour prendre un exemple extrême, un homme qui ne posséderait pas la force d'oublier et serait condamné à voir en toute chose un devenir : un tel homme ne croirait plus à sa propre existence, ne croirait plus en soi, il verrait tout se dissoudre en une multitude de points mouvants et perdrait pied dans ce torrent du devenir : en véritable disciple d'Héraclite[1], il finirait par ne même plus oser lever un doigt. Toute action exige l'oubli, de même que toute vie organique exige non seulement la lumière, mais aussi l'obscurité. Un homme qui voudrait sentir les choses de façon absolument et exclusivement historique ressemblerait à quelqu'un qu'on aurait contraint à se priver de sommeil ou à un animal qui ne devrait vivre que de ruminer continuellement les mêmes aliments. Il est donc possible de vivre, et même de vivre heureux, presque sans aucune mémoire, comme le montre l'animal ; mais il est absolument impossible de vivre sans oubli. Ou bien, pour m'expliquer encore plus simplement sur mon sujet : il y a un degré d'insomnie, de rumination, de sens historique, au-delà duquel l'être vivant se trouve ébranlé et finalement détruit, qu'il s'agisse d'un individu, d'un peuple ou d'une civilisation.
Qu'il s'agisse du plus petit ou du plus grand, il est toujours une chose par laquelle le bonheur devient le bonheur : la faculté d'oublier ou bien, en termes plus savants, la faculté de sentir les choses, aussi longtemps que dure le bonheur, en dehors de toute perspective historique. Celui qui ne sait pas s'installer au seuil de l'instant, en oubliant tout le passé, celui qui ne sait pas, telle une déesse de la victoire, se tenir debout sur un seul point, sans crainte et sans vertige, celui-là ne saura jamais ce qu'est le bonheur, pis encore : il ne fera jamais rien qui rende les autres heureux. Représentez-vous, pour prendre un exemple extrême, un homme qui ne posséderait pas la force d'oublier et serait condamné à voir en toute chose un devenir : un tel homme ne croirait plus à sa propre existence, ne croirait plus en soi, il verrait tout se dissoudre en une multitude de points mouvants et perdrait pied dans ce torrent du devenir : en véritable disciple d'Héraclite[1], il finirait par ne même plus oser lever un doigt. Toute action exige l'oubli, de même que toute vie organique exige non seulement la lumière, mais aussi l'obscurité. Un homme qui voudrait sentir les choses de façon absolument et exclusivement historique ressemblerait à quelqu'un qu'on aurait contraint à se priver de sommeil ou à un animal qui ne devrait vivre que de ruminer continuellement les mêmes aliments. Il est donc possible de vivre, et même de vivre heureux, presque sans aucune mémoire, comme le montre l'animal ; mais il est absolument impossible de vivre sans oubli. Ou bien, pour m'expliquer encore plus simplement sur mon sujet : il y a un degré d'insomnie, de rumination, de sens historique, au-delà duquel l'être vivant se trouve ébranlé et finalement détruit, qu'il s'agisse d'un individu, d'un peuple ou d'une civilisation.Friedrich Nietzsche, Considérations inactuelles (1874)
-
Ronsard : "Mignonne allons voir si la rose"

Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avait éclose
Sa robe de pourpre au soleil
A point perdu cette vesprée
Les plis de sa robe pourprée
Et son teint au vôtre pareil
Las, voyez comme en peu d'espace
Mignonne, elle a dessus la place
Las, ses beautés laissé choir
Ô vraiment marâtre Nature
Puis qu'une telle fleur ne dure
Que du matin jusques au soir
Lors, si vous me croyez, mignonne
Tandis que votre âge fleuronne
En sa plus verte nouveauté
Cueillez, cueillez votre jeunesse
Comme à cette fleur la vieillesse
Fera ternir votre beauté.Pierre de Ronsard, "Mignonne allons voir si la rose", Les Odes (1550-1552)
-
"Retour vers le futur"
-
Bachelard : "Le temps pur est mal connu"

J'ai souvent fait cette petite expérience dans mes cours à Dijon, le temps vide, uniforme inactif -- s'il existe—n'a plus qu'une qualité: sa durée : essayons donc de mesurer cette durée, de nombrer cette uniformité. Et je proposais à mes bleues d'apprécier en secondes un laps de temps déterminé. Je commençais en leur rappelant la solide objectivité de l'année, du jour de l'heure de la minute, de la seconde. Je leur rappelais aussi avec quelle sécurité ils se servaient, dans la vie commune de ces notions. Je leur demandais alors de compter le nombre de secondes d'un silence général que j'appréciais moi-même en suivant l'expérience sur mon chronomètre.
Je fus très frappé des résultats de cette enquête. Dans une classe de quarante élèves, les appréciations varièrent du simple au quintuple; il y eut des étudiants qui trouvèrent 30 secondes dans une minute, tandis que d'autres en trouvèrent 150. Je recommençai cette expérience plusieurs lois, avec des étudiants différents et toujours d'une manière impromptue. Les résultats furent toujours aussi divergents. On peut immédiatement en conclure que le temps pur est bien mal connu ; il est, je crois, d'autant plus mal connu qu'il est plus vidé, moins actif, privé des relations qui permettent de le mesurer. Dès qu'on est débarrasse des repères objectifs, on mesure le temps à la besogne que l'on tait plutôt que de mesurer la besogne au temps qu'elle réclame.
Gaston Bachelard, La continuité et la multiplicité temporelles (1937)
Photo : Engin Akyurt - Pexels
-
Bachelard : "Le temps n'a qu'une réalité, celle de l'Instant"
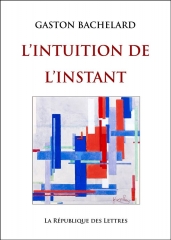 Le temps n'a qu'une réalité, celle de l'Instant. Autrement dit, le temps est une réalité resserrée sur l'instant et suspendue entre deux néants. Le temps pourra sans doute renaître, mais il lui faudra d'abord mourir. Il ne pourra pas transporter son être d'un instant sur un autre pour en faire une durée. L'instant c'est déjà la solitude... C'est la solitude dans sa valeur métaphysique la plus dépouillée. Mais une solitude d'un ordre plus sentimental confirme le tragique isolement de l'instant: par une sorte de violence créatrice, le temps limité à l'instant nous isole non seulement des autres mais de nous‑mêmes, puisqu'il rompt avec notre passé le plus cher.
Le temps n'a qu'une réalité, celle de l'Instant. Autrement dit, le temps est une réalité resserrée sur l'instant et suspendue entre deux néants. Le temps pourra sans doute renaître, mais il lui faudra d'abord mourir. Il ne pourra pas transporter son être d'un instant sur un autre pour en faire une durée. L'instant c'est déjà la solitude... C'est la solitude dans sa valeur métaphysique la plus dépouillée. Mais une solitude d'un ordre plus sentimental confirme le tragique isolement de l'instant: par une sorte de violence créatrice, le temps limité à l'instant nous isole non seulement des autres mais de nous‑mêmes, puisqu'il rompt avec notre passé le plus cher.Ce caractère dramatique de l'instant est peut‑être susceptible d'en faire pressentir la réalité. Ce que nous voudrions souligner c'est que dans une telle rupture de l'être, I'idée du discontinu s'impose sans conteste. On objectera peut‑être que ces instants dramatiques séparent deux durées plus monotones. Mais nous appelons monotone et régulière toute évolution que nous n'examinons pas avec une attention passionnée. Si notre cœur était assez large pour aimer la vie dans son détail, nous verrions que tous les instants sont à la fois des donateurs et des spoliateurs et qu'une nouveauté jeune ou tragique, toujours soudaine, ne cesse d'illustrer la discontinuité essentielle du Temps.
Gaston Bachelard, L'Intuition de l'Instant (1932)
-
Proust : la madeleine
 « Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher, n'existait plus pour moi, quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petites Madeleines qui semblent avoir été moulés dans la valve rainurée d'une coquille de Saint- Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse: ou plutôt cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venaitelle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender ? (…)
« Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher, n'existait plus pour moi, quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petites Madeleines qui semblent avoir été moulés dans la valve rainurée d'une coquille de Saint- Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse: ou plutôt cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venaitelle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender ? (…)Et tout d'un coup le souvenir m'est apparu. Ce goût c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray (parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe), quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté; peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents; peut-être parce que de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé; les formes - et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel, sous son plissage sévère et dévot - s'étaient abolies, ou, ensommeillées, avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante (quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux), aussitôt la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon, donnant sur le jardin, qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières (ce pan tronqué que seul j'avais revu jusque là) ; et avec la maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, la Place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau, de petits morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, de même maintenant toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l'église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardins, de ma tasse de thé. »
Marcel Proust, Du côté de chez Swann (1913)
-
"La machine à explorer le temps"
-
HG Wells : La machine à explorer le temps

Je m'attristai à mesurer en pensée la brièveté du rêve de l'intelligence humaine. Elle s'était suicidée ; elle s'était fermement mise en route vers le confort et le bien-être, vers une société équilibrée, avec sécurité et stabilité comme mots d'ordre ; elle avait atteint son but, pour en arriver finalement à cela. Un jour, la vie et la propriété avaient dû atteindre une sûreté presque absolue. Le riche avait été assuré de son opulence et de son bien-être ; le travailleur, de sa vie et de son travail. Sans doute, dans ce monde parfait, il n'y avait eu aucun problème inutile, aucune question qui n'eût été résolue. Et une grande quiétude s'était ensuivie.
C'est une loi naturelle trop négligée : la versatilité intellectuelle est le revers de la disparition du danger et de l'inquiétude. Un animal en harmonie parfaite avec son milieu est un pur mécanisme. La nature ne fait jamais appel à l'intelligence que si l'habitude et l'instinct sont insuffisants. Il n'y a pas d'intelligence là où il n'y a ni changement, ni besoin de changement. Seuls ont part à l'intelligence les animaux qui ont à affronter une grande variété de besoins et de dangers.
HG Wells, La Machine à explorer le Temps (1895)
-
Henri Bergson : Ces deux mémoires...
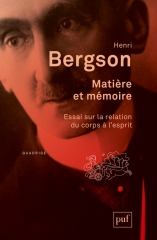 De ces deux mémoires, dont l'une imagine et dont l'autre répète, la seconde peut suppléer la première et souvent même en donner l'illusion. Quand le chien accueille son maître par des aboiements joyeux et des caresses, il le reconnaît, sans aucun doute; mais cette reconnaissance implique‑t‑elle l'évocation d'une image passée et le rapprochement de cette image avec la perception présente ? Ne consiste‑t‑elle pas plutôt dans la conscience que prend l'animal d'une certaine attitude spéciale adoptée par son corps, attitude que ses rapports familiers avec son maître lui ont composée peu à peu, et que la seule perception du maî tre provoque maintenant chez lui mécaniquement ? N'allons pas trop loin ! chez l'animal lui‑même, de vagues images du passé débordent peut‑être la perception présente; on concevrait même que son passé tout entier fût virtuellement dessiné dans sa conscience; mais ce passé ne l'intéresse pas assez pour le détacher du présent qui le fascine, et sa reconnaissance doit être plutôt vécue que pensée. Pour évoquer le passé sous forme d'image, il faut pouvoir s'abstraire de l'action présente, il faut savoir attacher du prix à l'inutile, il faut vouloir rêver. L'homme seul est peut‑être capable d'un effort de ce genre. Encore le passé où nous remontons ainsi est‑il glissant, toujours sur le point de nous échapper, comme si cette mémoire régressive était contrariée par l'autre mémoire, plus naturelle, dont le mouvement en avant nous porte à agir et à vivre.
De ces deux mémoires, dont l'une imagine et dont l'autre répète, la seconde peut suppléer la première et souvent même en donner l'illusion. Quand le chien accueille son maître par des aboiements joyeux et des caresses, il le reconnaît, sans aucun doute; mais cette reconnaissance implique‑t‑elle l'évocation d'une image passée et le rapprochement de cette image avec la perception présente ? Ne consiste‑t‑elle pas plutôt dans la conscience que prend l'animal d'une certaine attitude spéciale adoptée par son corps, attitude que ses rapports familiers avec son maître lui ont composée peu à peu, et que la seule perception du maî tre provoque maintenant chez lui mécaniquement ? N'allons pas trop loin ! chez l'animal lui‑même, de vagues images du passé débordent peut‑être la perception présente; on concevrait même que son passé tout entier fût virtuellement dessiné dans sa conscience; mais ce passé ne l'intéresse pas assez pour le détacher du présent qui le fascine, et sa reconnaissance doit être plutôt vécue que pensée. Pour évoquer le passé sous forme d'image, il faut pouvoir s'abstraire de l'action présente, il faut savoir attacher du prix à l'inutile, il faut vouloir rêver. L'homme seul est peut‑être capable d'un effort de ce genre. Encore le passé où nous remontons ainsi est‑il glissant, toujours sur le point de nous échapper, comme si cette mémoire régressive était contrariée par l'autre mémoire, plus naturelle, dont le mouvement en avant nous porte à agir et à vivre.Henri Bergson, Matière et Mémoire, (1896)
-
Hume : Qu'est-ce que le temps ?

De même que nous recevons l'idée d'espace de la disposition des objets visibles et tangibles, de même nous formons l'idée de temps de la succession des idées et des impressions ; et il est impossible que le temps puisse jamais se présenter ou que l'esprit le perçoive isolément.
David Hume, Traité de la Nature humaine (1739-1740)
Photo : Cottonbro - Pexels
-
"Perdu de recherche"
-
Proust : A la recherche du temps perdu
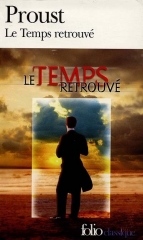 Me rappelant trop avec quelle indifférence relative Swann avait pu parler autrefois des jours où il était aimé, parce que sous cette phrase il voyait autre chose qu'eux, et de la douleur subite que lui avait causée la petite phrase de Vinteuil en lui rendant ces jours eux-mêmes tels qu'il les avait jadis sentis, je comprenais trop que ce que la sensation des dalles inégales, la raideur de la serviette, le goût de la madeleine avaient réveillé en moi, n'avait aucun rapport avec ce que je cherchais souvent à me rappeler de Venise, de Balbec, de Combray, à l'aide d'une mémoire uniforme ; et je comprenais que la vie pût être jugée médiocre, bien qu'à certains moments elle parût si belle, parce que dans le premier cas c'est sur tout autre chose qu'elle même, sur des images qui ne gardent rien d'elle qu'on la juge et qu'on la déprécie...
Me rappelant trop avec quelle indifférence relative Swann avait pu parler autrefois des jours où il était aimé, parce que sous cette phrase il voyait autre chose qu'eux, et de la douleur subite que lui avait causée la petite phrase de Vinteuil en lui rendant ces jours eux-mêmes tels qu'il les avait jadis sentis, je comprenais trop que ce que la sensation des dalles inégales, la raideur de la serviette, le goût de la madeleine avaient réveillé en moi, n'avait aucun rapport avec ce que je cherchais souvent à me rappeler de Venise, de Balbec, de Combray, à l'aide d'une mémoire uniforme ; et je comprenais que la vie pût être jugée médiocre, bien qu'à certains moments elle parût si belle, parce que dans le premier cas c'est sur tout autre chose qu'elle même, sur des images qui ne gardent rien d'elle qu'on la juge et qu'on la déprécie...Je glissais rapidement sur tout cela, plus impérieusement sollicité que j'étais de chercher la cause de cette félicité, du caractère de certitude avec lequel elle s'imposait, recherche ajournée autrefois. Or, cette cause, je la devinais en comparant entre elles ces diverses impressions bienheureuses et qui avaient entre elles ceci de commun que je les éprouvais à la fois dans le moment actuel et dans un moment éloigné où le bruit de la cuiller sur l'assiette, l'inégalité des dalles, le goût de la madeleine allaient jusqu'à faire empiéter le passé sur le présent, à me faire hésiter à savoir dans lequel des deux je me trouvais ; au vrai, l'être qui alors goûtait en moi cette impression la goûtait en ce qu'elle avait de commun dans un jour ancien et maintenant, dans ce qu'elle avait d'extra-temporel, un être qui n'apparaissait que quand, par une de ces identités entre le présent et le passé, il pouvait se trouver dans le seul milieu où il pût vivre, jouir de l'essence des choses, c'est-à-dire en dehors du temps. Cela expliquait que mes inquiétudes au sujet de ma mort eussent cessé au moment où j'avais reconnu, inconsciemment, le goût de la petite madeleine, puisqu'à ce moment-là l'être que j'avais été était un être extra-temporel, par conséquent insoucieux des vicissitudes de l'avenir. Cet être-là n'était jamais venu à moi, ne s'était jamais manifesté qu'en dehors de l'action, de la jouissance immédiate, chaque fois que le miracle d'une analogie m'avait fait échapper au présent. Seul il avait le pouvoir de me faire retrouver les jours anciens, le Temps Perdu, devant quoi les efforts de ma mémoire et de mon intelligence échouaient toujours.
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, Le Temps retrouvé (posth., 1927)

