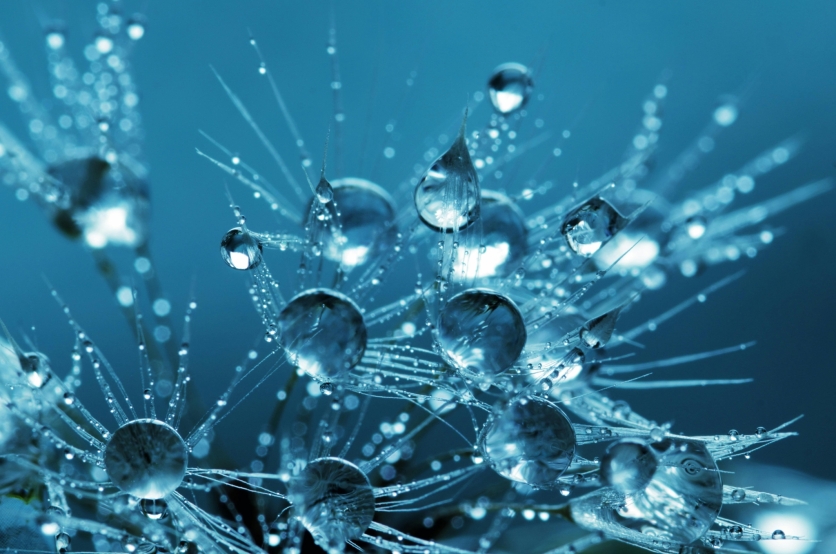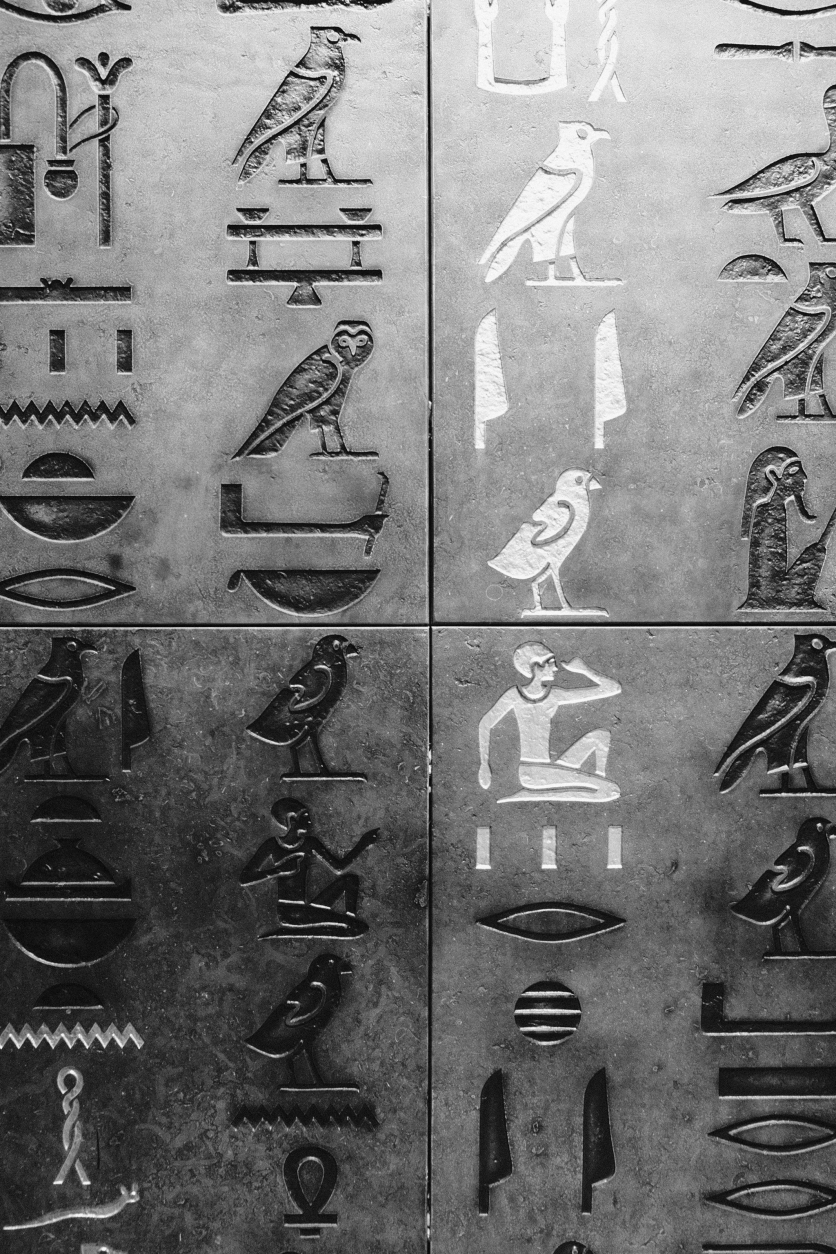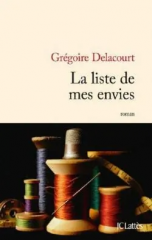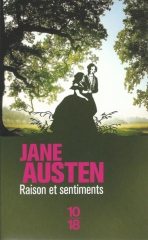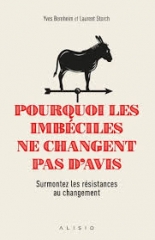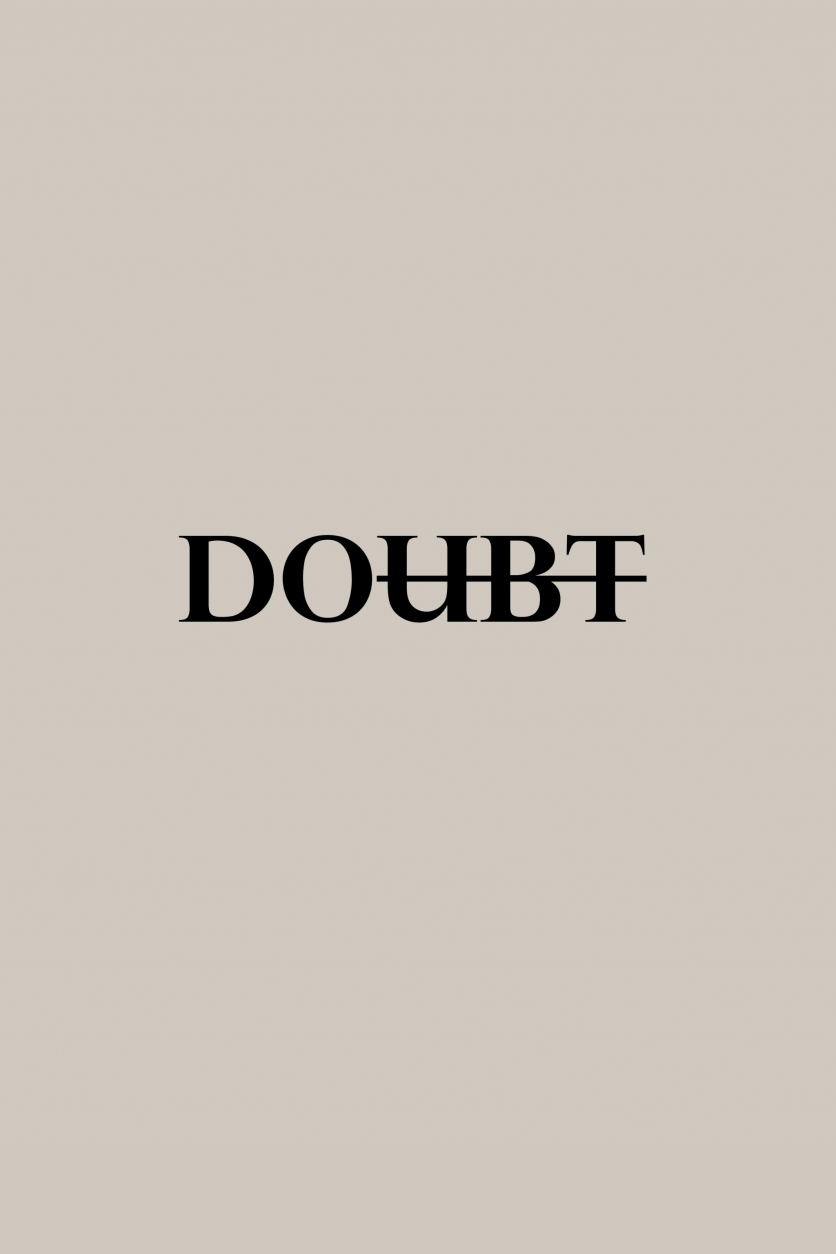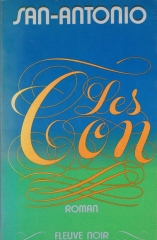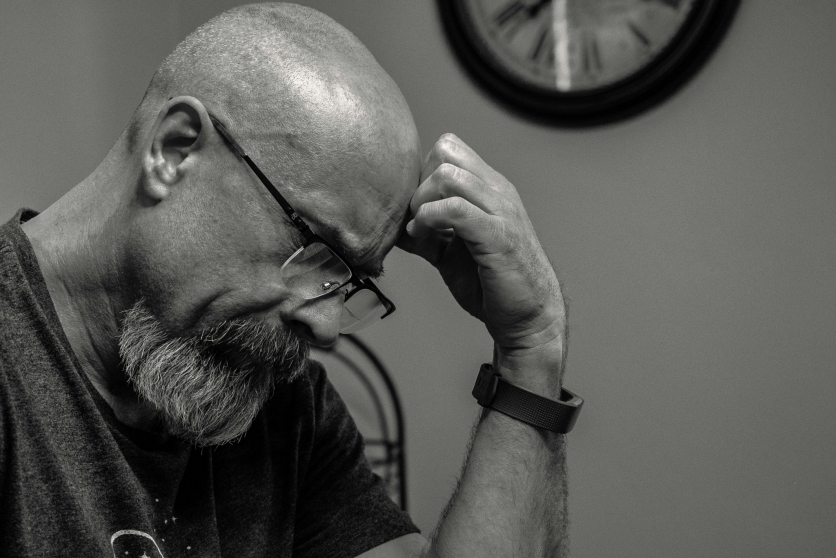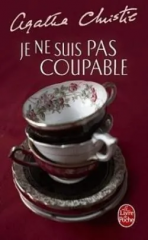Dans Le verrou, peint par Fragonard entre 1776 et 1780, la moitié gauche de la toile est occupée par le baldaquin et le désordre du lit. On y voit des tentures et des draperies magnifiquement peintes, dans la ligne de ces pans de tissus où on a vu s'affirmer et s'afficher dans le tableau le pictural et le peintre. Dès 1785, pourtant, ils sont expliqués en liaison avec le sujet de la toile : "un intérieur d'appartement dans lequel sont un jeune homme et une jeune fille : celui-ci fermant le verrou de la porte, l'autre s'efforçant de l'empêcher. La scène se passe auprès d'un lit, dont le désordre indique le reste du sujet". Sans doute... Mais à la condition d'ajouter que cette indication du "reste du sujet" se fait par un reste de peinture, de la peinture qui est, si l'on peut dire, "en reste", surplus ou résidu opaques de la transparence descriptive et narrative.
Ce désordre est en effet difficile à justifier aussi bien du point de vue de la vraisemblance descriptive de l'appartement que de la cohérence narrative de la scène qui s'y déroule : le cadrage de l'image exclut toute information sur la façon dont sont retenues ces immenses draperies suspendues, énoncées purement comme de la peinture de draperies dans le tableau, de la draperie de peinture. Par ailleurs, le désordre considérable de ces draperies et de la literie se fait mal comprendre narrativement dans la mesure où il semble indiquer qu'a été déjà consommé (et avec quelle énergie !) l'acte que tente d'empêcher la jeune fille et que voudrait protéger la fermeture du verrou...
Si, donc, le désordre du lit a quelque rapport avec ce reste du sujet qui ne serait pas représenté par l'action des figures, il n'indique pas ce reste selon la logique narrative de l'accessoire ou du détail "hiéroglyphique" à la manière de Greuze.
Le désordre du lit occupe la moitié de la toile, une zone qui, loin d'être "vide" comme on l'a malencontreusement écrit, est très pleine - de peinture précisément et d'une peinture dont la virtualité expressive obéit à ce que l'on pourrait appeler une logique configurative. S'amplifiant des dessins à l’œuvre, en même temps que l'ensemble se simplifie et évacue ses détails narratifs, les draperies et leur désordre précisent peu à peu leur organisation purement formelle pour devenir une figure de l'innommable "reste" du sujet : déplacés loin de la tête du lit (qui est située dans l'ombre vers l'extrême gauche de la toile), les oreillers se dessinent peu à peu pour faire surgir le profil d'une poitrine féminine qui s'enfoncerait dans l'ouverture rougeoyante de la draperie du fond et, en s'entrouvrant, les plis de cette dernière font deviner une secrète intimité, augurer la figure d'un sexe féminin. Au premier plan du lit, rendu visible par le rejet de la couverture, l'angle satiné du drap évoque une cuisse et un genou habillés du même tissu que le jupon de la jeune fille. Sur la gauche, la grande chute du rideau s'achève en deux gonflements vaguement sphériques qui ont l'air curieusement sans poids, reposant légèrement sur la table et ne suscitant pas la cassure affirmée que l'on attendrait dans la coulée rouge qui les domine - au point qu'on imaginerait presque ce tissu soulevé et tendu vers le haut plutôt que tombant sous son propre poids...
Ni narratif ni vide, ce désordre est plein de sens "virtuel". Les pans de tissu qui l'élaborent sont autant de pans de peinture où prend figure la pulsion des personnages, à "l'instant où le tout-puissant désir s'empare des deux êtres et les emporte irrésistiblement". Le reste, que le peintre ne pouvait pas décemment représenter, est présent, virtuel dans le corps même de la peinture, qui a charge de lui donner figure.
Des dessins à l'esquisse et à l’œuvre finale, le détail de cette configuration se précise à telle point qu'il n'a pu qu'être sciemment élaboré. (...) Plus encore que "l'objet du désir" que le peintre ne cesserait de "prendre pour objet", c'est le désir qui est ici, en lui-même, l'objet du peintre, son objet de peintre. L'idée proprement géniale que Fragonard élabore dans Le verrou consiste à figurer la force naturelle et surhumaine, sublime, de ce désir à travers l'emportement des figures, la syntaxe picturale de la peinture elle-même, et le détail d'une configuration déplacée.
Daniel Arasse, Le détail (1992)