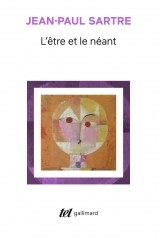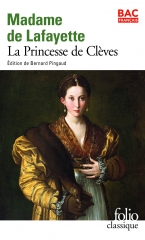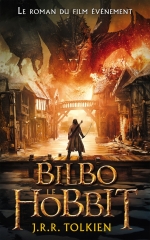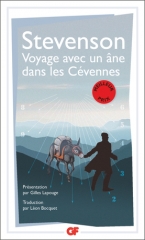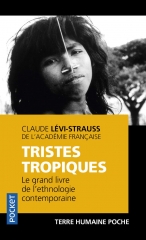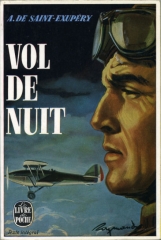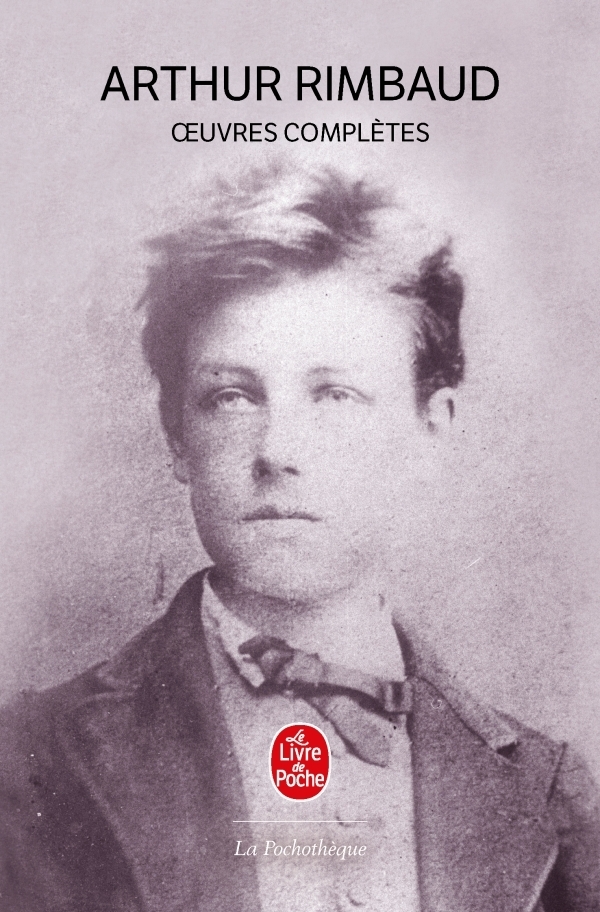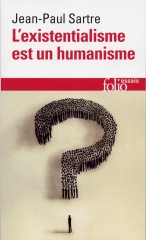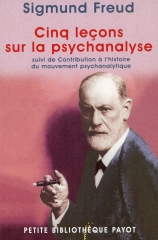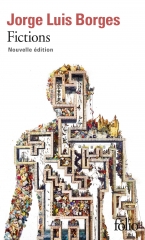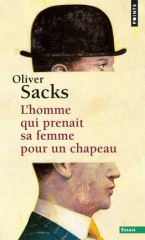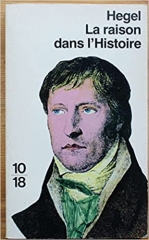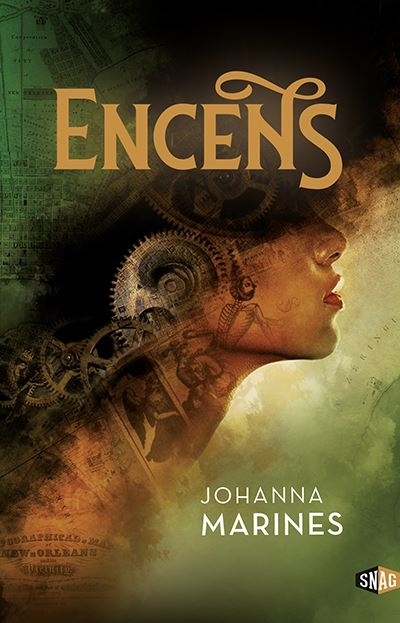Si, en nous plaçant d'un point de vue biologique, nous considérons maintenant la vie psychique, le concept de "pulsion" nous apparaît comme un concept-limite entre le psychique et le somatique, comme le représentant psychique des excitations, issues de l'intérieur du corps et parvenant au psychisme, comme une mesure de l'exigence de travail qui est imposée au psychique en conséquence de sa liaison au corporel.
Nous pouvons maintenant discuter quelques termes qui sont utilisés en rapport avec le concept de pulsion, comme : poussée, but, objet, source de la pulsion.
Par poussée d'une pulsion on entend le facteur moteur de celle-ci, la somme de force ou la mesure d'exigence de travail qu'elle représente. Le caractère « poussant » est une propriété générale des pulsions, et même l'essence de celles-ci. Toute pulsion est un morceau d'activité ; quand on parle, d'une façon relâchée, de pulsions passives, on ne peut rien vouloir dire d'autre que pulsions à but passif.
Le but d'une pulsion est toujours la satisfaction, qui ne peut être obtenue qu'en supprimant l'état d'excitation la source de la pulsion Mais, quoique ce but final reste invariable pour chaque pulsion, diverses voies peuvent mener au même but final, en sorte que différents buts, plus proches ou intermédiaires, peuvent s'offrir pour une pulsion ; ces buts se combinent ou s'échangent les uns avec les autres. L'expérience nous autorise aussi à parler de pulsions « inhibées quant au but », dans les cas de processus pour lesquels une certaine progression dans la voie de la satisfaction pulsionnelle est tolérée, mais qui, ensuite, subissent une inhibition ou une dérivation. On peut supposer que même de tels processus ne vont pas sans une satisfaction partielle.
L'objet de la pulsion est ce en quoi ou par quoi la pulsion peut atteindre son but. Il est ce qu'il y a de plus variable dans la pulsion, il ne lui est pas originairement lié : mais ce n'est qu'en raison de son aptitude particulière à rendre possible la satisfaction qu'il est adjoint. Ce n'est pas nécessairement un objet étranger, mais c'est tout aussi bien une partie du corps propre. Il peut être remplacé à volonté tout au long des destins que connaît la pulsion ; c'est à ce déplacement de la pulsion que revient rôle le plus important. Il peut arriver que le même objet serve simultanément à la satisfaction de plusieurs pulsions : c'est le cas de ce qu'Alfred Adler appelle l'entrecroisement des pulsions. Lorsque la liaison de la pulsion à l'objet est particulièrement intime, nous la distinguons par le terme de fixation. Elle se réalise souvent dans les périodes du tout début du développement de la pulsion et met fin à la mobilité de celle-ci en résistant intensément à toute dissolution.
Par source de la pulsion, on entend le processus somatique qui est localisé dans un organe ou une partie du corps et dont l'excitation est représentée dans la vie psychique par la pulsion. Nous ne savons pas si ce processus est strictement de nature chimique ou s'il peut aussi correspondre à une libération d'autres forces, mécaniques par exemple. l'étude des sources pulsionnelle déborde le champs de la psychologie."
Sigmund Freud, "Pulsions et destin des pulsions, in Métapsychologie (1912)
Photo : Pexels - Inna Mykytas
Depuis le XVIIIe siècle, le sexe n'a pas cessé de provoquer une sorte d'éréthisme discursif généralisé. Et ces discours sur le sexe ne se sont pas multipliés hors du pouvoir ou contre lui ; mais là même où il s'exerçait et comme moyen de son exercice ; partout ont été aménagées des incitations à parler, partout des dispositifs à entendre et à enregistrer, partout des procédures pour observer, interroger et formuler. On le débusque et on le contraint à une existence discursive. De l'impératif singulier qui impose à chacun de faire de sa sexualité un discours permanent, jusqu'aux mécanismes multiples qui, dans l'ordre de l'économie, de la pédagogie, de la médecine, de la justice, incitent, extraient, aménagent, institutionnalisent le discours du sexe, c'est une immense prolixité que notre civilisation a requise et organisée. Peut-être aucun autre type de société n'a jamais accumulé, et dans une histoire relativement si courte, une telle quantité de discours sur le sexe. De lui, il se pourrait bien que nous parlions plus que de toute autre chose ; nous nous acharnons à cette tâche ; nous nous convainquons par un étrange scrupule que nous n'en disons jamais assez, que nous sommes trop timides et peureux, que nous nous cachons l'aveuglante évidence par inertie et par soumission, et que l'essentiel nous échappe toujours, qu'il faut encore partir à sa recherche. Sur le sexe, la plus intarissable, la plus impatiente des sociétés, il se pourrait que ce soit la nôtre.