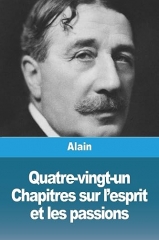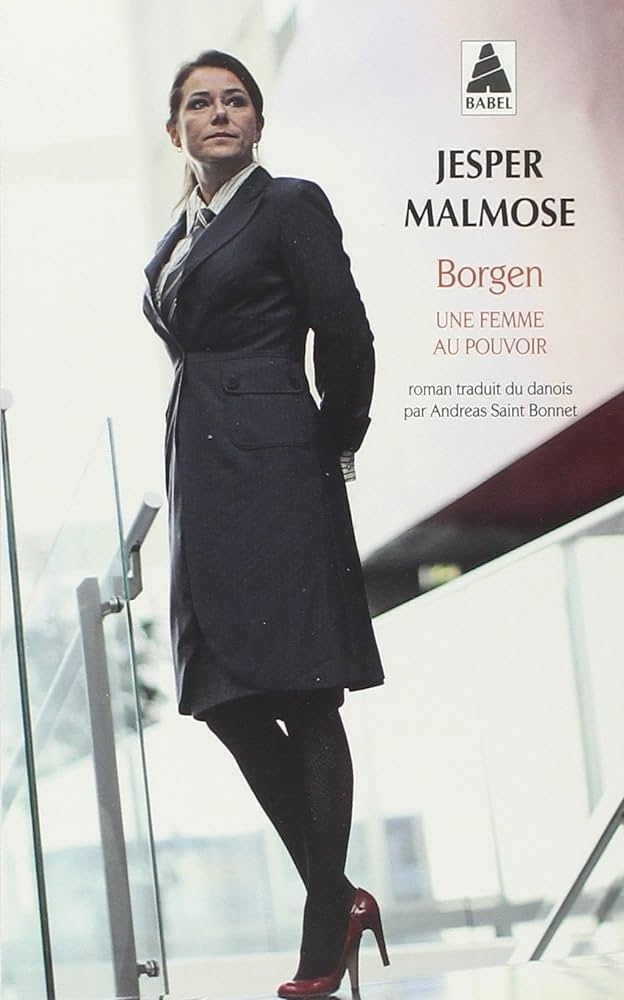Café philo janvier 2025
Nietzsche : Le degré de bonheur

Dans le plus petit comme dans le plus grand bonheur, il y a toujours quelque chose qui fait que le bonheur est un bonheur : la possibilité d'oublier, ou pour dire en termes plus savants, la faculté de se sentir pour un temps en dehors de l'histoire. L'homme qui est incapable de s'asseoir au seuil de l'instant en oubliant tous les évènements passés, celui qui ne peut pas, sans vertige et sans peur se dresser un instant tout debout comme une victoire, ne saura jamais ce qu'est un bonheur et ce qui est pareil ne fera jamais rien pour donner du bonheur aux autres. Imaginez l'exemple extrême: un homme qui serait incapable de rien oublier et qui serait condamné à ne voir partout qu'un devenir; celui la ne croirait plus en soi il verrait tout se dissoudre en une infinité de points mouvants et finirait par se perdre dans ce torrent du devenir. Finalement en vrai disciple d'Héraclite il n'oserait même plus bouger un doigt. Tout acte exige l'oubli comme la vie des êtres organiques exige non seulement la lumière mais aussi l'obscurité. Un homme qui ne voudrait rien voir qu'historiquement serait pareil à celui qu'on forcerait à s'abstenir de sommeil ou à l'animal qui ne devrait vivre que de ruminer et de ruminer sans fin. Donc, il est possible de vivre presque sans souvenir et de vivre heureux, comme le démontre l'animal mais il est impossible de vivre sans oublier. Ou plus simplement encore, il y a un degré d'insomnie, de rumination, de sens historique qui nuit au vivant et qui finit par le détruire, qu'il s'agisse d'un homme d'une nation ou d'une civilisation.
Friedrich Nietzsche, Secondes considérations intempestives (1874)
Photo : Pexels - Ivan urban